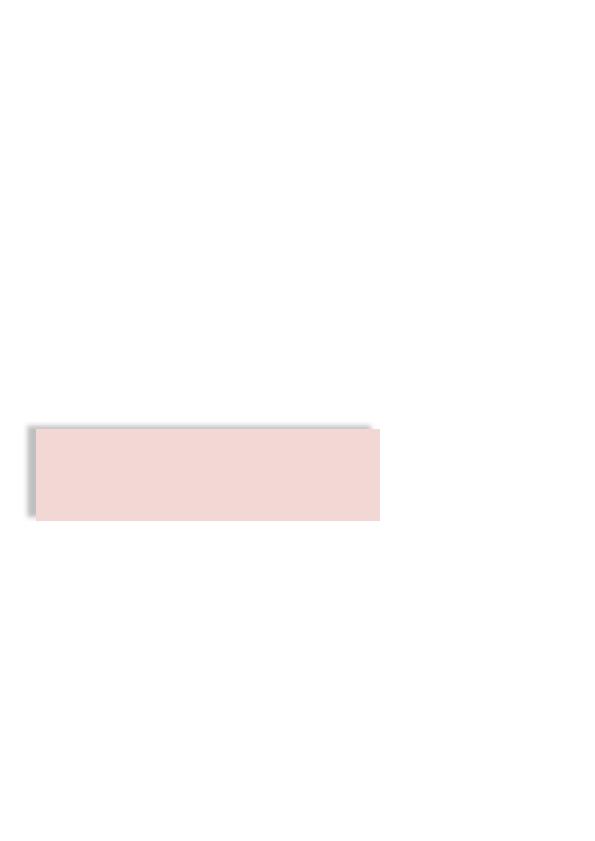
nétique et, d'autre part, de la plasticité
cérébrale: par exemple, la dépression et
l'isolement affectif «sculptent», au long
cours, l'espace de liberté du patient mais
aussi son cerveau compte tenu de son
travail journalier de traitement des affé-
rences sensorielles, leur retentissement
psychologique et les efférences motrices.
Cyrulnik insiste ainsi sur les actions fon-
damentales de parler, de s'exprimer, de
communiquer après un traumatisme:
ceci permet de diminuer la connotation
affective du traumatisme et renforce dès
lors l'importance de la thérapie narra-
tive, basée sur l'intentionnalité et l'anti-
cipation de la mémoire, auxquelles par-
ticipent plusieurs structures cérébrales,
non seulement le cortex préfrontal et
l'hippocampe, mais aussi le cervelet!
Ainsi, le lobotomisé ne souffre plus d'an-
goisse anticipatrice, mais n'est plus ca-
pable de raconter, c.-à-d. rechercher
dans son passé pour créer un récit.
de la mémoire: celle-ci est «vivante» car
elle se constitue mais se recompose conti-
nuellement au vu des sources d'informa-
tions qui peuvent différer. Il en arrive à
énoncer: «lorsqu'une personne fait un té-
moignage tout à fait différent d'une année
à l'autre, sur un sujet bien particulier, il ne
ment pas nécessairement car sa mémoire
peut avoir été changée...». D'autre part,
une femme enceinte stressée voit sa corti-
solémie s'élever et le taux de cortisol aug-
menter aussi dans le liquide amniotique.
Le foetus déglutit régulièrement le liquide
amniotique et s'expose ainsi à des taux
élevés de cortisol, ce qui peut avoir mau-
vaise influence sur le développement de
son hippocampe. Il s'agit dès lors d'un
mère, d'où la notion de précarité sociale.
giques, il insiste sur la structuration d'une
«image» en mémoire durable dans l'amyg-
dale, correspondant à une «hypermémoire»
de voix ou d'objet liés à l'agression,
en opposition avec l'hypomémoire de
l'environnement au moment de celle-ci:
ceci justifie des témoignages étonnam-
ment partiels! D'autre part, la trace mné-
sique amygdalienne peut être réveillée par
un des stimuli semblables à ceux enfouis
et engendrer dès lors une réaction an-
xieuse voire de panique, parfois difficile à
comprendre, surtout chez l'enfant. La du-
rée d'exposition à un traumatisme est aussi
importante: en cas d'événement court
(période d'examens...), le psychisme de
l'enfant s'adapte, mais si les faits traumati-
sants perdurent (longue procédure de di-
vorce parental conflictuel...), l'enfant peut
en arriver à sombrer dans une dépression.
sensorielle» correspondant à la famille,
particulièrement les parents père et/ou
mère qui peuvent créer par contact
corporel une base de sécurité qui s'inté-
riorise dans la mémoire du petit enfant.
Comme illustration, il donne l'exemple
des «parents-kangourous» dans la com-
munauté indienne de Colombie, qui
portent leur enfant dans un sac sur leur
thorax. A l'inverse, il signale que l'aban-
don est le comportement le plus dange-
reux pour un enfant. Certains travaux,
basés sur des études animales (rat) dé-
montreraient même un début d'atrophie
temporo-limbique droite après quelques
semaines de carence affective ou un
nier, affecter de manière irréversible le
fonctionnement de l'hippocampe, même
plus tard, à l'âge adulte (1). Ces travaux
rejoignent les connaissances bien éta-
blies chez les adultes où l'hippocampe,
contenant de hauts niveaux de récep-
teurs aux glucocorticoïdes, le rend plus
vulnérable au stress de par (2-3):
tains neurones hippocampaux;
le gyrus dentelé;
pyramidales de la région CA3.
rielle du nouveau-né ou de l'enfant, mo-
difie le développement de son cerveau.
Car une privation sensorielle altère le
fonctionnement synaptique de la zone
cérébrale, qui aurait dû traiter cette infor-
mation via une modification de la plasti-
cité cérébrale, tenant compte de la plasti-
cité cérébrale, qui est modulée par le
type d'afférences. Dès lors, un enfant se
développant dans un milieu affectif ap-
pauvri par un malheur parental (décès,
abandon, violences, précarité, dépres-
sion...) prend l'empreinte d'une base
d'insécurité (4). Tout stress fera désor-
mais l'objet d'une base d'insécurité et de
difficultés à le surmonter. L'épigénétique
transforme donc largement la base géné-
tique! Ceci rejoint la maxime d'Erasme
(1469-1536): «Homo fit, non nascitur»!
thérapeutiques
Salpêtrière (Paris), passe en revue les
aspects cliniques des troubles du
comportement de l'enfant et de
l'adolescent. Il insiste également sur
l'intérêt de faire la différence entre des
troubles du comportement consécutifs
d'abus physique (avec une présentation
dès lors plus antisociale) par rapport aux
abus émotionnels, voire de négligence,