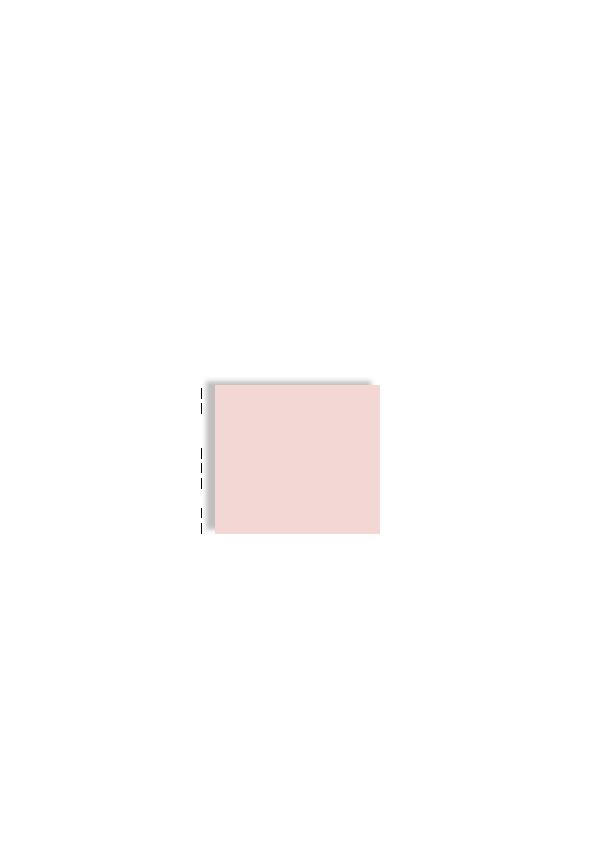
et le patient commence à raconter un
épisode de sa jeunesse avec des détails
très riches. L'épisode raconté est le plus
souvent banal, mais toujours empreint
d'une émotion heureuse: c'est la rémi-
niscence. La récupération des souvenirs
dure assez longtemps, de 10 à 20 mi-
nutes, avec un bonheur évident de se
retrouver et de pouvoir communiquer.
Dans bon nombre de cas, le sujet va en-
core plus loin: il décrit avec stupéfaction
et émerveillement la façon dont il revit
ses souvenirs. C'est alors une véritable
reviviscence. Si des airs bien choisis se
succèdent, ils vont alors réveiller d'autres
souvenirs et permettre la continuation
d'un dialogue heureux, sans fatigue et
toujours accompagné de joie.
les jours, compte tenu de l'amnésie anté-
rograde. Cependant, dans cette étude, la
fréquence des séances atteignait au
maximum 2 par semaine. Dans la quasi-
totalité des cas, le sujet Alzheimer recon-
naît le praticien, mais ne se souvient pas
des séances précédentes. Il reconnaît
l'interrogateur avec un sentiment très fort
de familiarité. Il garde ensuite une im-
pression très agréable, même s'il ne se
souvient plus de ce qu'il a fait. Enfin, la
répétition des séances entraîne un enri-
chissement des souvenirs, une améliora-
tion du dialogue et, surtout, une restruc-
turation identitaire qui reste à évaluer.
nos observations. C'est une émotion in-
tense qui s'accompagne d'une sensation
d'étonnement, d'imprévu, de dévoile-
ment. Elle se distingue du bonheur, émo-
tion douce, continue, apaisante. L'appa-
rition de la joie, dans nos observations,
précède les autres éléments, et en parti-
culier le souvenir. Ce n'est donc pas la
qualité musicale de l'air entendu, ni la
qualité du souvenir, d'autant plus que
banalité. L'explication proposée à ce
sentiment de joie serait liée au seul fait
de la reconnaissance.
On peut approcher d'une interprétation
de cette joie en tenant compte des deux
faits suivants: il existe deux sortes de
souvenirs: le souvenir factuel (on peut
décrire tous les faits qui le composent) et
le souvenir virtuel (on en sent toute sa
puissance mais sans en avoir les images
ni les mots; c'est la pensée sans langage,
le concept sans mot) (2, 3); et trois
niveaux de récupération du souvenir: le
niveau 1 est le souvenir immédiat («je
sais»); le niveau 2 correspond au souve-
nir différé («je sais que je sais») que l'on
pourrait qualifier de virtuel car inexpri-
mable à ce moment; enfin, le niveau 3
réfère au souvenir perdu («l'oubli de
l'oubli») ou encore «vide mental».
passage d'un niveau 3 à un niveau 2 de
récupération du souvenir. Le souvenir
n'est pas encore là, mais le souvenir
du souvenir vient de naître. On vient de
renouer avec nous-même, avec notre
continuité.
mélancolie, qui serait provoqué par le
réveil de souvenirs appartenant à un
temps qui n'est plus et qui ne sera jamais
plus? Cette crainte est justifiée et doit
toujours inciter à la prudence. Dans
cette expérience de «mnémothérapie»,
cela ne s'est jamais produit. La mémoire
involontaire est un mécanisme qui per-
bliés de faire irruption dans toute leur
pureté, c'est-à-dire sans effet comparatif
puisqu'ils sont vécus au présent. Mais
certains patients vont parfois marquer
des pauses dans ce processus de mé-
moire involontaire: c'est ce que l'on ap-
pelle le «temps du charme rompu». Il
s'agit alors d'un moment indiscutable de
nostalgie. Mais, pour que la nostalgie se
transforme en tristesse, mélancolie ou
déprime, il faudrait qu'il fasse une com-
paraison entre ce qu'il était et ce qu'il est
devenu. Le patient, ici, ne possède pas
les deux termes de la comparaison. C'est
un bonheur protégé.
moire antérograde chez la personne
Alzheimer, on pouvait craindre que la
musique soit un mauvais indice: en effet,
pour reconnaître un thème musical, il
faut être capable d'associer une dizaine
de notes successives et de reconnaître
les modalités de répétition pour juger
d'un rythme. Si cette association s'était
avérée impossible, ce projet aurait été en
échec. Dans cette expérience, cette mé-
moire musicale est pratiquement tou-
jours conservée, au moins pour les
phrases essentielles de la mélodie (re-
frain).
Dans notre expérience, les patients, et
ceci quel que soit le stade de la maladie,
ne nous semblaient pas encore justifier
le terme de démence, ni sur le plan éty-
mologique, ni sur le plan sociétal. Le
terme de démence implique stricto sen-
su la perte de son esprit (dé-mens) et,
pour les non médecins, un véritable état
de folie. Ce terme risque d'entraîner la
panique du patient et l'angoisse de la
famille, associées à un certain renonce-
ment. Or l'intelligence du raisonnement,
les mécanismes de la pensée, l'affectivi-
té, la propension au bonheur et les diffé-
rents talents artistiques ou autres qui ca-
ractérisent un individu restent présents
(on peut penser au peintre américain
William Utermohlen ou à l'actrice fran-