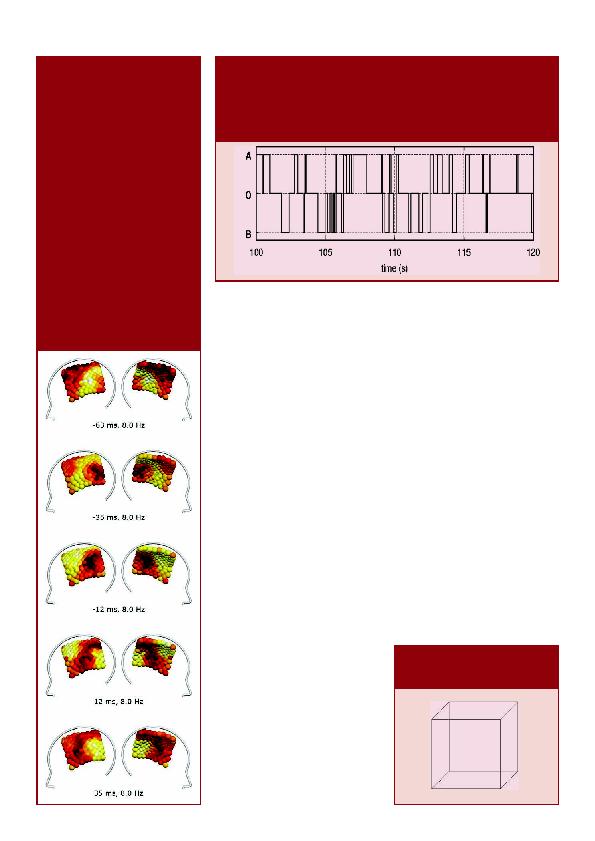
moins que le terme d'«EEG de repos» est
assez trompeur. Le cerveau n'est pas au
repos, mais anticipe les stimulus entrants
potentiellement pertinents. Les transi-
tions spontanées entre différents mouve-
ments témoignent de la flexibilité de
l'activité cérébrale. Nous pouvons égale-
ment interpréter les modèles d'activité
en perpétuel changement comme un
(vague) reflet de ce que William James
appelait le «train of thoughts», à savoir la
succession spontanée de sensations res-
senties par quiconque qui ne pense à
rien de précis. La corrélation entre la
succession de perceptions et des
modèles spécifiques d'activité cérébrale
a déjà été établie par le passé par Diet-
rich Lehmann, le premier à avoir étudié
ce type d'activité (7). Supposer que les
perceptions seraient chacune associées à
un modèle d'activité cérébrale spéci-
fique, c'est toutefois aller un pas trop
loin. Au contraire, nous pouvons même
constater, du moins pour certains types
de perceptions, que plusieurs chemins
mènent à Rome, de la même manière
qu'un symptôme peut généralement être
dû à différentes causes. Hiro Nakatani a
demandé à plusieurs sujets de regarder
une figure ambiguë, à savoir le cube de
Necker (Figure 3). Si nous observons
longtemps une telle figure, celle-ci
katani a demandé aux sujets d'appuyer
sur un bouton à chaque fois qu'ils per-
cevaient un changement d'orientation,
pendant qu'il enregistrait leur activité
cérébrale (8, 9). L'activité qui conduisait
à cette perception n'était pas toujours la
même (8). Nakatani est toutefois parve-
nu à distinguer un certain nombre de
types d'activité, qui révélaient parfois
un déplacement de l'attention vers une
autre partie de la figure et parfois une
nouvelle interprétation des informations
visuelles issues des aires de traitement
visuel précoces. Une activité cérébrale
pure et simple n'était pas toujours en
cause. En effet, il s'est avéré que les
mouvements oculaires et même les
clignements des yeux pouvaient en-
traîner un changement de perception de
la figure ambiguë (9). Autrement dit, le
mesurée au moyen des signaux électriques
à la surface du cerveau. Des électrodes
ont été implantées dans l'hémisphère
cérébral gauche d'un patient souffrant
d'épilepsie sévère, avant qu'il ne subisse
un traitement chirurgical.
Les deux photos de la tête montrent une
série d'électrodes, vues de la surface
externe (photo de gauche) et de la
surface interne (photo de droite).
L'onde a besoin d'environ 125
millisecondes pour traverser le cortex
cérébral. L'intervalle de temps est illustré
en dessous; le chiffre 0 correspond au
moment où le patient bouge ses doigts.
L'onde apparaît à l'arrière du cortex
cérébral et se propage vers l'avant.
Sur l'échelle de couleur, le pic de l'onde
est représenté par une couleur «chaude»
et le creux par une couleur «froide».
(A) et stationnaires (B). Entre celles-ci, on peut voir des situations caractérisées par une
activité plus irrégulière (O). Vous remarquerez que les transitions entre les différentes
situations sont brusques et qu'à première vue, ni la durée, ni l'alternance des mouvements
ne semblent régulières. Pourtant, l'alternance présente bel et bien une certaine régularité
ou, plus précisément, un caractère fractal (Ito et al., 2005).
ambigu utilisé dans les expériences de
Nakatani et al., 2005.