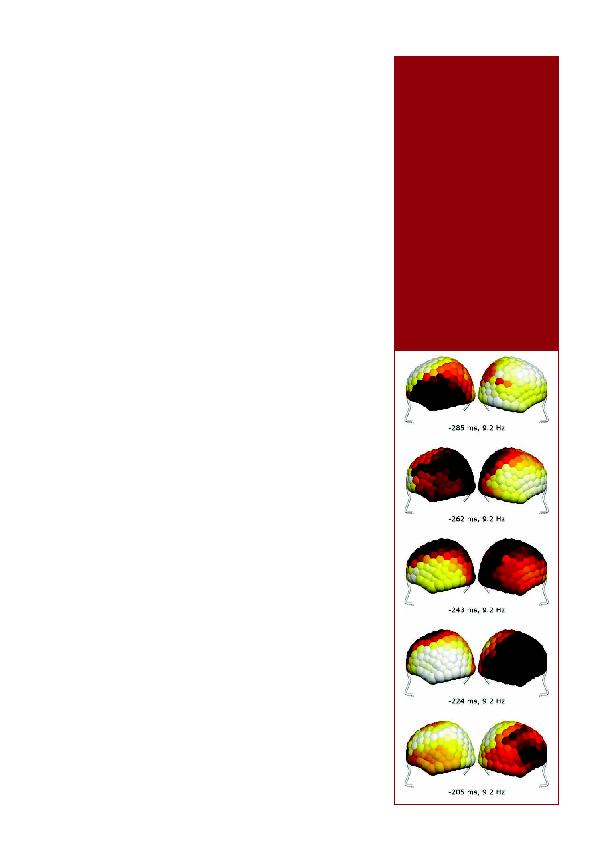
origines que l'observateur proprement
dit ne peut cependant pas distinguer. En
tant que chercheurs, nous devons donc
veiller à considérer la manière dont les
observateurs décrivent leur propre per-
ception selon leur perspective person-
nelle comme la meilleure possible.
Grâce à l'analyse correcte de l'activité
cérébrale, nous pouvons parfois dis-
tinguer des choses liées à la perception
personnelle avec plus de subtilité que
l'observateur proprement dit.
muli illustrent également très bien le fait
que plusieurs chemins mènent à Rome.
Lorsque nous soumettons un sujet à
stimulus, ce dernier génère également
une onde d'activation à travers
l'ensemble du cortex (Figure 4). Dans ce
cas, l'activation se propage de gauche à
droite. Toutefois, lors de la présentation
ultérieure du même stimulus, l'activation
peut se propager de droite à gauche,
d'avant en arrière ou d'arrière en avant
(3). Cela dépend de l'activité qui la
précède, à savoir l'activité spontanée.
Même si quelqu'un répète le même
mouvement, comme tapoter des doigts,
le centre de la motricité dans le cerveau
est à chaque fois sollicité (localement).
Pourtant, c'est une autre onde qui tra-
verse le cortex cérébral dans son ensem-
ble. La figure 5 illustre cela à l'aide d'un
exemple, dans lequel le même stimulus
est présenté deux fois et la même tâche
est effectuée à deux reprises. Les gra-
phiques montrent les modèles d'ondes
pour chacun de ces cas de figure.
Ces modèles diffèrent considérablement;
les moments et les fréquences sont
différents. La personne était peut-être
intéressée la première fois et s'ennuyait
la deuxième, ou il est possible que
quelqu'un ait d'autres pensées et inten-
tions lors du mouvement. Le sens des
ondes est également significatif. Ainsi, il
est évident, par exemple, que les ondes
se propagent plus d'arrière en avant chez
cérébral est unique. Cette simple obser-
vation a d'énormes conséquences sur la
manière dont nous devrons aborder les
fonctions cérébrales. Il est vrai que des
chercheurs ont constaté une grande vari-
ation des signaux générés à la suite de la
présentation d'un stimulus, mais que
celle-ci pouvait être considérée comme
une variation aléatoire et qu'il était donc
possible d'établir des moyennes sur de
grands nombres de mesures répétées.
Nous avons constaté que ce rai-
sonnement est erroné et que la variation
n'est pas exclusivement le fruit du
hasard, mais repose sur la dynamique
qui précède le signal. Ne pas tenir
compte de cette donnée dans le calcul
des moyennes revient à additionner des
pommes et des poires. C'est pourquoi les
moyennes ne reflètent pas ce qui se
passe réellement dans le cerveau.
Le calcul de moyennes sur de nombreu-
ses répétitions a cependant été jugé
nécessaire, car le signal mesuré à la sur-
face du cuir chevelu s'avérait parasité et
peu fiable. Toutefois, selon nous, cela est
uniquement dû au fait que nous n'avions
pas bien compris le signal. Générale-
ment, les scientifiques examinent les
fonctions cérébrales en recherchant ce
que l'on appelle des sources d'activité
locale. On essaie alors de relier cette
activité à une ou plusieurs aires du cer-
veau. Ainsi, pour les processus langa-
giers, on trouve un centre d'activité lo-
cale dans les aires de Brodmann, raison
pour laquelle on affirme que c'est à cet
endroit que se déroule le traitement du
langage. L'arrivée de l'IRMf (imagerie
par résonance magnétique fonction-
nelle) n'a fait que renforcer cette ap-
proche. En effet, elle permet d'examiner
plus facilement et de déterminer plus
précisément les sources d'activité locale
sur la base de la consommation
d'oxygène dans certaines régions du
cerveau.
mesurée au moyen du champ magnétique
généré par cette activité à la surface de la
tête. Sur la photo de gauche, on peut voir
le côté gauche de la tête et sur la photo de
droite, le côté droit. Cette onde a besoin
d'environ 100 millisecondes pour
traverser toute la surface du cerveau.
L'onde part du bas de la partie gauche de
la tête et se propage vers l'avant, au bas
de la partie droite. La majeure partie du
champ magnétique dans cette vidéo est
généré par l'activité cérébrale à proximité
de la surface du cortex cérébral.
L'intervalle de temps est illustré en dessous;
le chiffre 0 correspond au moment où la
personne appuie sur un bouton de
réponse. Sur l'échelle de couleur, le pic
de l'onde est représenté par une couleur
«chaude» et le creux par une couleur
«froide».