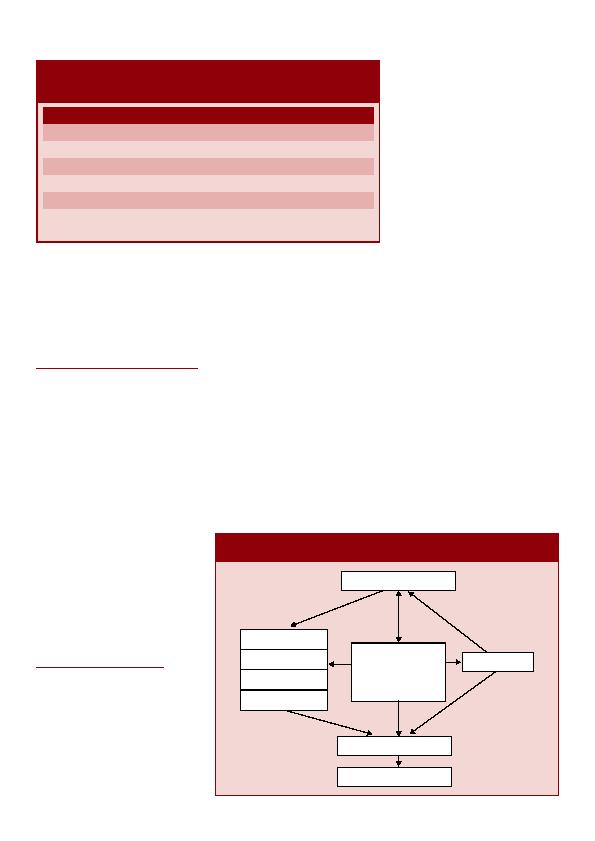
chotiques qui expliquent le risque accru
d'affections cardiométaboliques chez les
personnes souffrant de dépression. La
ces mécanismes sous-jacents.
sonnes dépressives ont, de manière gé-
nérale, un mode de vie beaucoup moins
sain. Les dépressifs fument plus, font trop
peu d'exercice physique, consomment
davantage d'alcool et ont une alimenta-
tion moins équilibrée. Il s'agit donc ici
de facteurs de risque classiques. En cas
de dépression, ces facteurs ont la même
influence que chez les personnes in-
demnes d'affections psychiatriques, mais
ils sont beaucoup plus fréquents et plus
sévères chez les sujets dépressifs (5). Par
ailleurs, les personnes dépressives res-
pectent moins bien les traitements pres-
crits (6). Une compliance thérapeutique
moindre réduit dès lors les chances de
survie de ces patients (6).
niques sont caractéristiques des mala-
dies cardiométaboliques autant que de
la dépression. Il s'agit ici entre autres
du dérèglement du système nerveux
autonome, de l'hyperactivité de l'axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien
(axe HHS), d'une présence majorée de fac-
tion de l'activité plaquettaire (7, 8). La
présence de ces facteurs de risque, tant
en cas de dépression que de maladies
cardiométaboliques, peut potentielle-
ment expliquer la relation entre les deux
tableaux cliniques.
nerveux autonome (la partie du système
nerveux qui est responsable de tous les
processus automatiques, tels que la res-
piration, la transpiration, la fréquence
cardiaque et la digestion) fonctionne dif-
féremment chez les personnes souffrant
de dépression, ce phénomène étant im-
putable au stress continu et aux tensions
qu'elles éprouvent. La partie du système
réaction «fright-flight-fight» (le système
nerveux sympathique) est plus active,
tandis que l'activité de la partie respon-
sable du repos et de la digestion, notam-
ment (le système nerveux parasympa-
thique) diminue (9). Cette modification
se traduit par une accélération de la fré-
quence cardiaque et une diminution de
la variabilité de la fréquence cardiaque
(les fluctuations de la fréquence car-
diaque) (10). Ce sont précisément ces
deux caractéristiques témoignant d'un
mauvais fonctionnement du système
nerveux autonome qui, chacune en soi,
constituent des facteurs de risque pour
les maladies cardiovasculaires (10).
que la dépression est associée à une aug-
mentation des taux de cortisol, une hor-
mone stéroïdienne impliquée dans l'axe
HHS. L'exposition constante à des taux
de cortisol élevés peut également entraî-
ner des maladies cardiovasculaires (12).
Il est donc possible que la relation entre
la dépression et les maladies cardiomé-
taboliques soit influencée par un sys-
tème nerveux autonome dysfonctionnel,
et par une élévation chronique des taux
de cortisol.
modifiables pour les maladies cardiovasculaires chez les personnes souffrant de dépression
majeure, par rapport à la population générale (4).
cardiovasculaires.