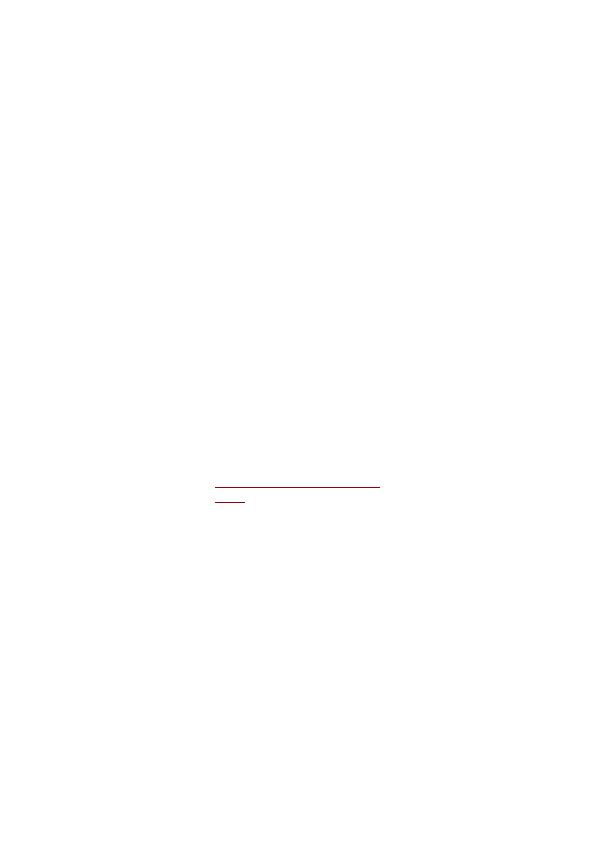
un rôle important en cas de schizophrénie,
à l'instar de la sérotonine en cas d'anxiété
et d'agressivité. Depuis lors, le glutamate
et la glycine sont également avancés
comme «nouveaux» neurotransmetteurs,
et il est vraisemblable que d'autres sui-
vront encore. Les théories se complexi-
fient, suite à toutes sortes de tours de
passe-passe rappelant les cercles de Ptolé-
mée, pour pouvoir traiter le nombre expo-
nentiellement croissant de «faits» expéri-
mentaux... mais on y comprend de moins
en moins. Et bien que chaque nouvelle
pièce du puzzle augmente la confusion,
on prétend que le puzzle deviendra petit à
petit complet et transparent.
Peut-être avons-nous tout simplement
besoin d'un nouveau paradigme... Dans
«Making Social Science Matter», Bjent
Flyvbjerg, un professeur d'université à
Oxford, argue que les sciences humaines
y compris donc la psychiatrie doivent
être restructurées de manière différente,
plutôt que de vouloir être une copie cari-
caturale des sciences naturelles...
psychiatrie actuelle
tient, à l'exclure en tant qu'être narratif et
parlant, et à le présenter comme entièrement
soumis à des déterminismes biologiques et
génétiques, en excluant ses libres possibilités
de choix. Tout ceci alors que le système se
prétend athéorique, ce qui est en soi une
contradictio in terminis puisque tout classe-
ment sous-tend une prise de position. Les
prises de position qui sont défendues dans ce
système sont donc totalement inconscientes,
mais n'en sont que plus néfastes. En outre,
cela témoigne d'un manque de vision an-
thropologique, et le système n'envisage pas
la moindre relation entre les différents ta-
bleaux cliniques. Tous ces problèmes font
que ce système ne peut servir de base fiable
à une réflexion sérieuse au sujet de la psy-
chiatrie et de son développement. Pourtant,
ce système de consensus américain a le
culot de s'imposer au reste du monde.
parti dans le cadre de cet article, je ten-
terai cependant volontiers de prouver
cette allégation en citant une expérience
réalisée par Jacques Schotte en 1999
(12). Schotte voulait démontrer que les
critères du DSM ne conviennent pas
pour diagnostiquer une dépression,
comparativement aux critères anthropo-
psychiatriques. Via un point de vue ingé-
nieux, on a dosé le taux de thyrotropin
releasing hormone chez tous les patients
dépressifs participant à l'étude, en tant
que marqueur du tonus vital. Les critères
du trouble dépressif majeur selon le
DSM, qui sont corrélés à ce marqueur
biologique, se sont effectivement avérés
beaucoup moins fiables que le critère
d'anhormie de l'anthropopsychiatrie.
Mieux encore: le critère d'anhormie
pouvait englober toute une série de pa-
tients présentant une diminution de la
réponse au TRH, lesquels n'étaient pas
considérés comme dépressifs selon les
critères du DSM. Il en ressort que le cri-
tère anthropopsychiatrique est incontes-
tablement supérieur.
social
gique éclipse non seulement l'aspect
psychologique au sein de la psychopa-
thologie, mais peut-être encore davan-
tage l'aspect social. Exemple: la relation
entre la fréquence des suicides et les
chiffres de vente des antidépresseurs. Si
tout va bien, nous pouvons nous attendre
à un rapport inversement proportionnel.
Pourtant, que voit-on? La Belgique fait
partie du peloton de tête en termes de
ventes d'antidépresseurs et détient éga-
lement un des taux de suicides les plus
élevés en Europe! Comprenne qui pour-
ra. Ici, des facteurs biologiques jouent
donc incontestablement un rôle.
En raison de son intérêt pour et de sa
théorisation de l'Autre, Lacan a déjà
introduit la psychanalyse au sein de la
dimension sociale, beaucoup plus que
d'objet, où l'autre reste pour ainsi dire un
objet. Suite à la relation entre le sujet di-
visé par rapport à l'autre, d'une part, et à
la théorie freudo-szondienne des pulsions
qui oscille entre le psychique et le soma-
tique, d'autre part, la scission du biotope
humain en biologique, psychologique et
sociologique s'avère superflue. Il s'agit en
effet d'un vaste ensemble complexe. De-
puis «Unbehagen in der Kultur» (Malaise
dans la civilisation) et «Massenpsycholo-
gie und Ich-analyse» (Psychologie des
masses et analyse du Moi), nous savons
que tous les phénomènes sociaux sont
des projections et des agrandissements
des dynamiques intrapsychiques. C'est
ainsi que le système judiciaire représente
la fonction paternelle, tandis que la sécu-
rité sociale représente un principe mater-
nel. Ceci constitue une donnée cruciale
dans la réflexion au sujet de ces systèmes
et de leur relation avec la santé mentale.
qui paraîtra dans le prochain numéro de
Neurone, nous analyserons davantage la
relation entre l'anthropopsychiatrie et la
politique, et nous proposerons quelques
solutions à des problèmes rencontrés au
sein de la psychiatrie actuelle.
Qu'est-ce donc en définitive que l'anthropopsychiatrie?
Malheureusement, dans le cadre (étroit) de cet article, il n'est
pas possible de le développer plus en détail. J'invite ceux qui
désireraient en savoir plus à consulter mon livre «Naar een
andere psychiatrie» (Vers une autre psychiatrie) (6).
1.
research: consequences for researchers, clinicians, policy
makers and patients, Psychoanalytische Perspectieven
2013; 321(1):59-78.
an main 2005.
Perspective, J. Neurosci 2009;29:12748-56,.
Neuropsychanalyse 2010.
Huber Verlag, 1972.
college, Boom, 1990.
l'anthropopsychiatrie: étude comparative des diagnostics
«Dépression Majeure» (DSM) et anhormie (approche
phénoménologique-clinique), corrélés au test TRH chez
138 patients ambulatoires, L'information psychiatrique
1999;6(75).