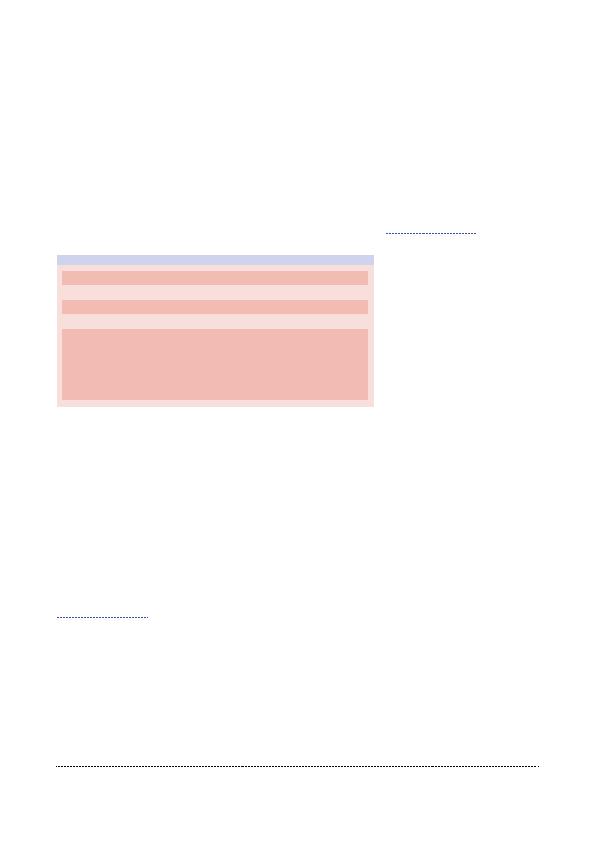
pule qu'aucun produit cosmétique com-
mercialisé ne peut contenir de cortico-
stéroïdes ou de trétinoïne. L'annexe III de
cette directive mentionne les substances
interdites et qui ne peuvent figurer dans
les cosmétiques que si elles répondent
aux limitations précisées. Suivant cette
annexe, l'hydroquinone n'est autorisée
qu'en tant que colorant capillaire oxy-
dant, ainsi que pour le modelage d'ongles
artificiels. L'utilisation en tant qu'agent
dépigmentant est toutefois interdite. En
dépit de leur efficacité, les ingrédients
susmentionnés ont des effets indésirables
être utilisés en toute sécurité sans suivi
médical. En outre, il faut tenir compte
du fait que ces produits dépigmentants
sont le plus souvent utilisés pendant une
longue période, essentiellement au niveau
du visage, des mains et du décolleté. Ils
contiennent également souvent des in-
grédients kératolytiques, qui augmentent
l'absorption dermique des substances dé-
pigmentantes. De ce fait, les cosmétiques
dépigmentants qui contiennent ce type
d'ingrédients sont non seulement illé-
gaux, mais ils représentent également un
danger pour la santé de l'utilisateur.
COSMÉTIQUES ILLÉGAUX
par définition tous les produits cosmé-
tiques qui ne sont pas conformes à la
législation cosmétique européenne (par
ex. conditionnement non conforme, pré-
sence d'ingrédients interdits). Le carac-
tère illégal des produits décrits ici est dû
au fait qu'ils contiennent un ingrédient
dépigmentant interdit.
teurs de cosmétiques dépigmentants
font partie de la population africaine et
asiatique et que ces continents jouent
un rôle important dans la production
et la distribution des contrefaçons mé-
dicamenteuses, on admet de manière
générale que les cosmétiques illégaux
atteignent le marché belge de la même
manière que les contrefaçons médi-
camenteuses (3). Le transport vers le
marché européen est stimulé par les
immigrés qui recherchent, dans leur pays
d'accueil, les produits qu'ils utilisaient
déjà dans leur pays d'origine (4).
on Drugs and Crimes (UNODC, 2008),
qui traite des contrefaçons, signale que
55% des contrefaçons saisies aux fron-
tières européennes proviennent de
Chine; 10% proviennent de Thaïlande et
1% de Hong Kong. Parmi tous les pro-
duits saisis, 4% sont des cosmétiques
qui aboutissent sur le marché belge via
deux importantes voies de transport, en
l'occurrence la navigation fluviale et le
transport aérien (3, 4).
transport de 81% de la totalité des
contrefaçons. Ceci explique pourquoi
les pays européens possédant des ports
importants tels que les Pays-Bas (Rot-
terdam), l'Allemagne (Hambourg) et la
Belgique (Anvers) sont les endroits où le
plus grand nombre d'articles sont saisis.
que de 6% de toutes les contrefaçons
transportées, mais ce canal ne peut
néanmoins être sous-estimé. Abstraction
saisis, cette voie est cependant respon-
sable du plus grand nombre de cas. Cette
voie est donc principalement utilisée par
des particuliers, afin de transporter illé-
galement de petites quantités, souvent
destinées à leur utilisation personnelle.
le marché européen, ils sont principa-
lement vendus dans des magasins dits
d'ethno-cosmétique, sur le marché noir
et sur Internet (3, 4).
tion avec la VUB, un nouveau projet de
recherche visant à étudier la probléma-
tique des contrefaçons cosmétiques.
A cet égard, les anciennes méthodes
d'analyse des cosmétiques ont été rem-
placées par des techniques modernes,
plus fiables. La méthode développée en
définitive est basée sur une analyse par
spectrométrie de masse lors de laquelle
une chromatographie liquide à ultra-
haute pression (Ultra High Pressure Liquid
Chromatography ou UHPLC) est couplée
à un détecteur du temps de vol (Time Of
Flight ou TOF). La méthode est capable
d'analyser des crèmes, des lotions, des
gels, des savons et des huiles, soit les for-
mulations dépigmentantes les plus cou-
rantes. La méthode développée détecte
tant les produits dépigmentants légaux
qu'illégaux. Le tableau 1 reprend un
aperçu des constituants qui peuvent être
détectés. La sensibilité de la méthode
varie de 15ppb pour l'hydroquinone à
100ppt pour les corticostéroïdes.
suspects saisis par la douane (aéro)por-
tuaire ou par l'inspection de la Direc-
tion générale Animaux, Végétaux et Ali-
mentation (DG4) ont été analysés via
cette nouvelle méthode. Les premiers
résultats indiquent que plus de la moitié
des échantillons contiennent de l'acide
salicylique, un agent kératolytique connu
qui assure une exfoliation de la peau, ce
qui augmente l'absorption dermique des
autres ingrédients. Par ailleurs, il s'avère
que 2 échantillons sur 3 sont positifs
pour un agent dépigmentant illégal.
17-valérate de bêtaméthasone
Propionate de clobétasol
Dipropionate de bêtaméthasone
Trétinoïne