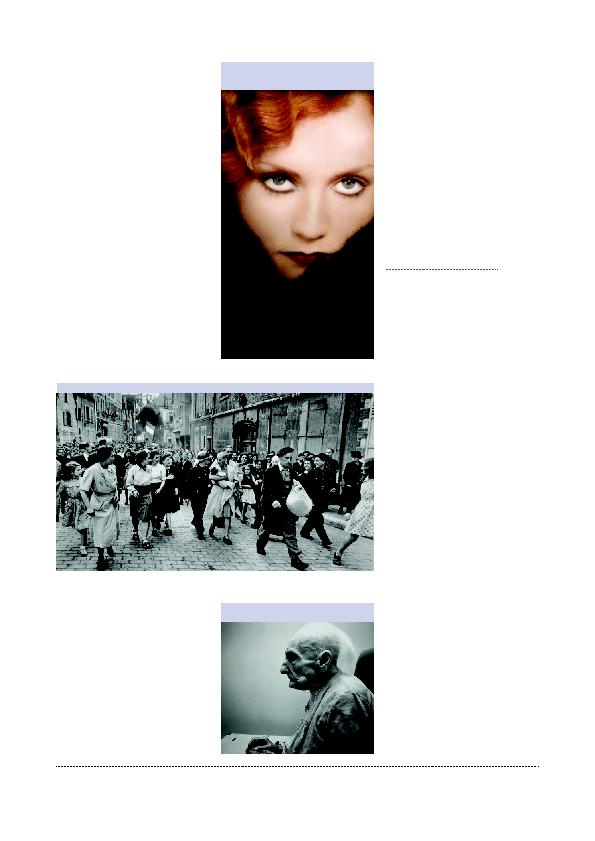
couleurs très variées, dont certaines sont
associées à des caractéristiques particu-
lières. Le blond, associé aux saints, à la
vierge Marie et aux anges, est assimilé
à la réserve et à l'innocence. La préfé-
rence pour les cheveux blonds remonte
pratiquement à la nuit des temps. En
l'an 100 avant Jésus-Christ, les premiers
peuples mésopotamiens utilisaient déjà
une poudre blanche pour éclaircir leurs
cheveux et leur barbe. Les Grecs et les
Romains aussi considéraient le blond
comme la couleur de cheveux la plus
esthétique. Au Moyen Age, on vouait un
culte aux jeunes filles blondes. Ce n'est
qu'à partir du 18
en Europe. A cette époque, les contacts
avec les autres cultures s'intensifient.
L'exotisme gagne en visibilité. Les cou-
leurs foncées évoquent l'aventure et le
suspense. Puis arrive Marilyn Monroe, qui
remet le blond platine au goût du jour.
Elle sera suivie par Doris Day, Grace Kelly,
femmes au visage d'ange. Aujourd'hui
encore, les hommes semblent associer
la blondeur à la discrétion, à la douceur
et à la fragilité, peut-être parce que cela
leur permet de se sentir plus virils. Histo-
riquement, les rousses sont considérées
comme des femmes passionnées, mais
aussi infidèles et malhonnêtes. Aussi,
elles ont souvent inspiré les artistes.
Dans l'expo, on peut voir une magnifique
photo d'Isabelle Huppert, prise pendant
le tournage de «Violette Nozière», le
tient le rôle principal (Figure 2). Le film
a pour thème la libération des carcans de
la morale traditionnelle. Selon les normes
de l'époque, Violette Nozière, qui n'avait
aucune envie de vivre la vie de femme au
foyer à laquelle elle était destinée, devait
avant tout devenir une bonne mère. A la
mort de ses parents, elle est accusée de
les avoir assassinés au moyen de som-
nifères. Elle est finalement condamnée à
mort sans la moindre preuve de sa culpa-
bilité. Un débat de société s'ensuivra et
elle deviendra un symbole de révolte
contre l'ordre social.
crée à la «PERTE» des cheveux. C'était
pour ça que j'étais venue. Toutefois,
contrairement à ce qui était écrit dans
le prospectus, l'expo n'accorde pas la
moindre attention aux aspects médicaux
de la chute des cheveux. Malgré cela, je
me suis laissée captiver par les autres as-
pects. Se tondre ou se faire tondre peut
être assimilé à une perte d'une partie de
l'intimité et de la personnalité. Cela peut
se faire sur une base volontaire, notam-
ment lorsqu'une personne entre dans un
ordre religieux, par exemple un monas-
tère. Pour les religieux, un crâne chauve
est un symbole de renoncement à la
sexualité et à l'individualité. Les boud-
dhistes aussi se rasent le crâne en signe
de détachement et d'ascétisme. Il peut
aussi s'agir d'une forme de sanction. La
figure 3
prise à Chartres en 1944, au lendemain
de la libération. Au centre, on peut voir
une jeune femme tondue avec un bébé
dans les bras, entourée par une foule mo-
queuse. Cette femme était une Française
de 22 ans qui avait eu un enfant avec
un soldat allemand. Rien qu'en France,
pas moins de 20.000 femmes auraient
été tondues après la guerre, soit parce
qu'elles faisaient du commerce avec les
Allemands, soit parce qu'elles étaient
servante chez une famille allemande.
dans le cadre du deuil. Au 17
bague ou un médaillon dans lequel des