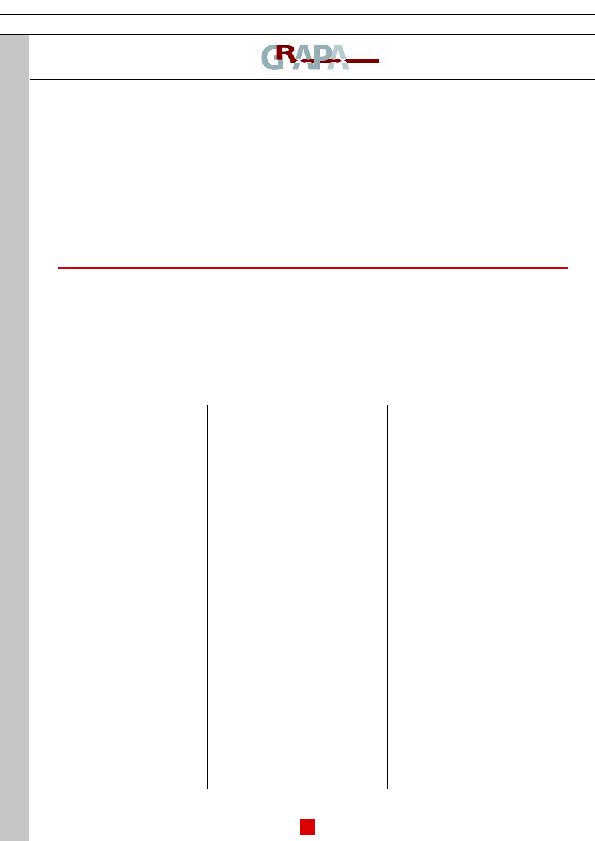
des héparines est indépendant de l'âge.
Celles-ci se lient à l'antithrombine, dont
elles potentialisent (de l'ordre de 1.000
fois) l'action inhibitrice des facteurs Xa
et iia (thrombine) et à un degré moindre
des facteurs iXa, Xia et Xiia de la cas-
cade de la coagulation. la séquence per-
mettant la liaison des chaînes d'héparine
à l'antithrombine est constituée d'un en-
chaînement particulier de cinq sucres for-
mant le «pentasaccharide» naturel. Cette
notion est à la base du développement de
nouveaux anticoagulants comme le pen-
tasaccharide synthétique (fondaparinux)
ou à longue durée d'action (idraparinux).
plus courte, interagissent surtout avec
le facteur Xa et peu avec la thrombine.
de fait, elles sont caractérisées par un
rapport activité anti-Xa/anti-iia toujours
supérieur à 1, mais variant selon les mo-
lécules. Compte tenu de l'hétérogénéité
des préparations d'HBPM, ce rapport
varie en pratique entre 2 et 4 (1,6 pour
la tinzaparine), 3,3 pour la nadroparine,
3,9 pour l'enoxaparine. lorsque l'activité
anti-iia est relativement importante, elle
peut retentir sur le temps de céphaline
le cas avec la tinzaparine).
risation chimique ou digestion enzyma-
tique des chaînes d'héparines non frac-
tionnées. les étapes et les méthodes de
fabrication sont différentes selon les spé-
cialités et font de chaque HBPM un agent
thérapeutique spécifique. les HBPM
sont caractérisées par un poids molécu-
laire moyen inférieur à 8.000da (2.000 à
8.000). Bien que les étapes de fabrication
soient optimisées, rigoureusement sui-
vies et standardisées, les diverses HBPM
présentent des différences en termes de
structure moléculaire et de propriétés
fonctionnelles. les degrés de sulfatation
sont aussi différents. ainsi, la tinzapa-
rine, avec un poids moléculaire moyen de
6.500da, est l'HBPM la plus richement
sulfatée et dont la bio disponibilité et l'éli-
mination rénale sont les plus proches de
l'héparine non fractionnée. Son utilisa-
tion doit néanmoins rester prudente chez
la personne âgée avec insuffisance rénale
(GFr < 30ml/min).
téines plasmatiques, au facteur plaquet-
taire 4, aux cellules endothéliales et aux
macrophages. Près de 90% des HBPM
sont éliminées par voie rénale et une
faible proportion est retrouvée dans les
fèces. leur élimination est essentiel-
lement rénale, d'où le risque d'accu-
mulation en cas d'insuffisance rénale,
fréquemment présente chez les patients
âgés. leur biodisponibilité, après admi-
nistration par voie sous-cutanée, est
proche de 100%. Elles ont une demi-vie
de l'ordre de 3 à 6 heures et leur pharma-
cocinétique est indépendante de la dose.
leur effet pharmacologique est prévi-
sible et reproductible, et c'est la raison
pour laquelle leur surveillance biologique
peut être simplifiée.
tageuses des HBPM leur ont permis de
supplanter les héparines non fraction-
nées: la meilleure biodisponibilité, la
réduction du nombre d'injections et une
clairance indépendante de la dose, du
moins en l'absence d'insuffisance rénale,
en font des préparations dont l'activité
anticoagulante est plus prédictible et plus
sûre. Ceci permet l'utilisation des HBPM