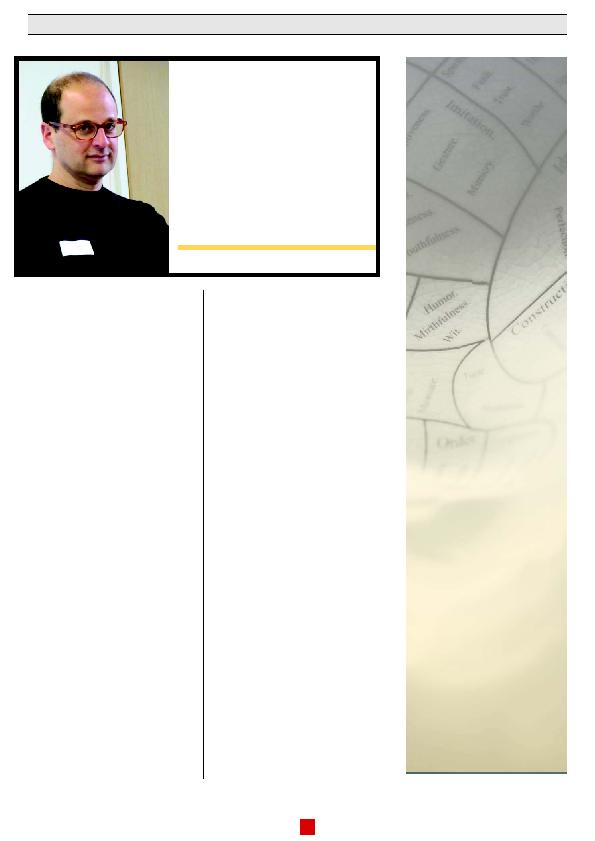
sive ou mélancolique, état hypomaniaque
ou maniaque, troubles cyclothymiques ou
dysthymiques...), la dynamique même des
troubles, la limite des approches pharmaco-
thérapeutiques, l'approche privilégiée et la
formation des psychothérapeutes, la demande
du patient ou de ses proches...».
personnel qu'à la littérature scientifi que
que le dr Souery a tenté de répondre après
avoir précisé que «les médicaments psycho-
tropes autrefois disponibles agissaient sur la
pensée autant sur le plan quantitatif, ce qui
peut interférer avec un travail de psychothé-
rapie, que sur le plan qualitatif (lorsqu'il est
délirant par exemple). Les nouveaux neu-
roleptiques ont moins cet effet secondaire
d'`anesthésie' de la pensée. A côté de cela,
on dispose aussi de nouveaux antidépres-
seurs qui, on le sait aujourd'hui, n'atténuent
pas les capacités d'élaboration de la pensée
ni son contenu. Quant aux stabilisateurs de
l'humeur, on peut rapprocher dans ce sens
aux antidépresseurs. Cela dit, les travaux
scientifi ques de neuroscience et de psychothé-
rapie, notamment pour la thérapie cognitivo-
comportementale psychanalytique, montrent
sur la base d'imagerie fonctionnelle, après un
à deux ans, des modifi cations cérébrales, un
peu comme si elles agissaient sur le plan épi-
génétique. Et permettent un remaniement de
voies neuronales. En résumé, toute infl uence
extérieure, même psychothérapeutique, peut
amener des rééquilibrages, des `réparations'
arguments que je dis à mes patients qu'un trai-
tement neuroleptique prescrit à dose normale
n'entrave pas un travail psychothérapeutique.
J'irais même plus loin car j'estime que les deux
approches vont dans le même sens, celui de la
réparation neurophysiologique».
dépressif lorsqu'il est très symptomatique,
doit recevoir dans un premier sens un
traitement médicamenteux qui permette
de réparer un déséquilibre neurophysio-
logique. après plusieurs années, lorsque
la partie physiologique de la maladie sera
quasi `éteinte', et pourra laisser une place
à une meilleure introspection, une meil-
leure connaissance des confl its existentiels,
le traitement médicamenteux sera souvent
moins nécessaire. Certains patients pour-
ront donc, à terme, diminuer voire se passer
de médicaments.
tients traités soit par chimiothérapie simple,
soit par psychothérapie simple, soit combinée,
et elles ont montré que c'est le traitement
combiné qui donne les meilleurs résultats
en termes de rapidité de l'amélioration. Les
deux approches ne sont donc absolument pas
exclusives, même s'il ne semble pas oppor-
tun que la même personne effectue les deux
approches: l'acte de prescrire revêt en effet
une autre symbolique, plus `dirigiste'. Cela
dit, si l'acte de prescrire est indissociable de
la parole et peut être un accompagnement de
la psychothérapie, on ne peut oublier l'impor-
tance de la psychoéducation».
n'est pas une
simple situation de
communication, mais
c'est-à-dire, dans un temps et un
espace donnés, la mise en place
d'une technique précise, une éthique
à respecter, un objectif, deux sujets
ou plus, engagés dans une relation
déterminée. Elle vise à soulager le
patient en lui permettant de discuter
et/ou d'exprimer ses émotions, en
l'aidant à changer ses attitudes, ses
comportements et des habitudes qui
pourraient lui être néfastes. Possédant
un certain savoir, le psychothérapeute
est aussi un sujet compétent et formé.
progressivement des spéculations
religieuses et métaphysiques avec le
développement de la psychologie,
connaît son essor avec la découverte, à
la fi n du XiX
est restée longtemps la méthode
psychothérapique de référence.
doit favoriser un rapport de confi ance
entre le patient et le thérapeute, ce que
l'on désigne sous le terme d' «alliance
thérapeutique».
psychothérapies. Schématiquement,
on peut les classer en deux catégories
générales:
- les psychothérapies structurées à
comportementales et cognitives;