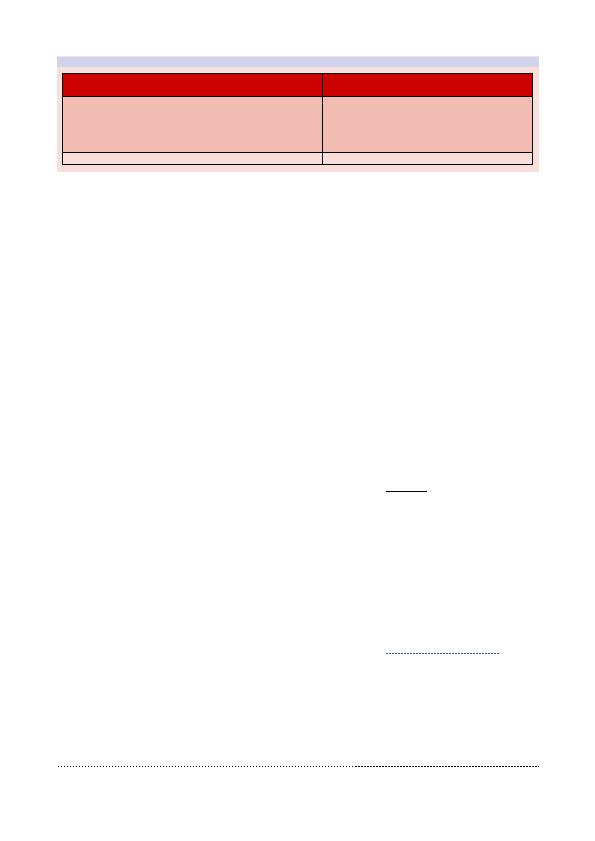
antiseptiques les plus utilisés (Tableau 2).
marché des médicaments contre la dou-
leur chronique. La plupart des recherches
en matière de lutte contre la douleur
sont américaines. Il était donc prévi-
sible qu'une partie de l'atelier traite
de l'anesthésie. Il existe suffisamment
de preuves pour affirmer que dans bon
nombre de cas, la douleur chronique
résulte d'une douleur aiguë mal trai-
tée. Cette découverte, conjuguée au
grand nombre de réclamations en dom-
mages et intérêts, a probablement attiré
l'attention sur un traitement antidouleur
adéquat et l'expérience globale durant
l'intervention. Joslyn Kirby (Hershey,
Pennsylvania State University) a com-
muniqué quelques conseils pratiques.
Les manoeuvres de dérivation, l'injection
lente d'un anesthésique réchauffé à
l'aide d'une aiguille fine et l'ajout de
bicarbonate à la lidocaïne peuvent tous
contribuer à une meilleure tolérance de
l'anesthésie.
un excès de produit: pour la lidocaïne
sans adrénaline, la dose maximale est
de 4,5mg/kg. pour la lidocaïne + adré-
naline, cette dose s'élève à 7mg/kg. Cela
signifie donc que la dose maximale de
lidocaïne + adrénaline pour un patient
de 70kg est de 49ml. Un autre mythe
très répandu, à proscrire, veut que
l'adrénaline ne peut pas être utilisée
pour les extrémités, au risque de pro-
voquer une nécrose. Cette idée fausse
(probablement par prudence) a ainsi été
transmise depuis plus de 100 ans, de
génération en génération de médecins.
Des données récentes relatives à des
injections accidentelles par «Epipen®»
de hautes doses d'adrénaline dans les
doigts ont montré l'absence de nécrose.
Il existe une multitude de techniques de
bien avisés d'approfondir quelque peu
leurs connaissances en la matière, car
certaines plaies difficiles à refermer po-
sent bien moins de problèmes avec des
types de suture particuliers. De plus, les
sutures ne doivent pas uniquement ser-
vir à refermer totalement un défaut. Elles
permettent aussi de réduire un défaut,
afin de diminuer la surface à granuler en
seconde intention.
vanie) a présenté quelques techniques
utiles, selon elle:
- le point en croix: principalement pour
biopsie à l'emporte-pièce;
plaies très étendues;
un défaut en seconde intention;
sible aux endroits délicats.
d'un lambeau, Allison Vidimos (Cleve-
land, Ohio) énonce cette règle simple à
suivre en toutes circonstances: «Function
before form and form before cosmetics».
La décision du lambeau à utiliser dépend
des caractéristiques de la plaie, des uni-
tés cosmétiques, de l'anatomie perti-
nente et des spécificités de la peau. Le
patient doit en avoir pris connaissance
auparavant. Un formulaire de «consen-
tement éclairé» reprenant ces informa-
tions peut lui être présenté.
(Hershey, Pennsylvania State University)
conseille de tenir compte du fonctionne-
ment réel des tissus. Les caractéristiques
du défaut déterminent le bon déroule-
ment des différentes étapes de la gué-
- 0-48h: imbibition: diffusion. L'irriga-
la plaie environnante sanglante;
connectent l'une à l'autre;
- > 2 semaines: ré-innervation sensorielle.
de la greffe:
- santé générale du patient: diabète,
l'hypoderme;
les premiers jours;
greffe sont essentielles à la réussite.
pansement. pour les greffes, on utilise des
sutures en faufil tout autour du greffon.
toutefois, on emploie parfois également
un bourdonnet. Il s'agit d'une sorte de
compresse fixée de manière à exercer
une pression continue sur la greffe. Le
contact est ainsi optimal avec les tissus
sous-jacents, ce qui permet l'imbibition et
l'inosculation. pour les plaies à suture nor-
male, on peut appliquer de la vaseline sur
la blessure, ainsi qu'un pansement asep-
tique sec habituel, selon la préférence du
médecin et les caractéristiques de la plaie.
ThéRAPiE NéoADJUVANTE
EN CAS DE ChiRURGiE DE
TUMEURS BASoCELLULAiRES
tement des adultes qui présentent un
carcinome basocellulaire métastasé,
localement récidivant ou avancé, ou ne
Hématologie, ferritine
TSH, HbA1c
Anticorps antinucléaires (SSA/SSB)
Vitamine B1, B2, B6, B12, D, zinc, magnésium
Hypothyroïdie? Diabète sucré?
Sjögren?
Carences en vitamines?