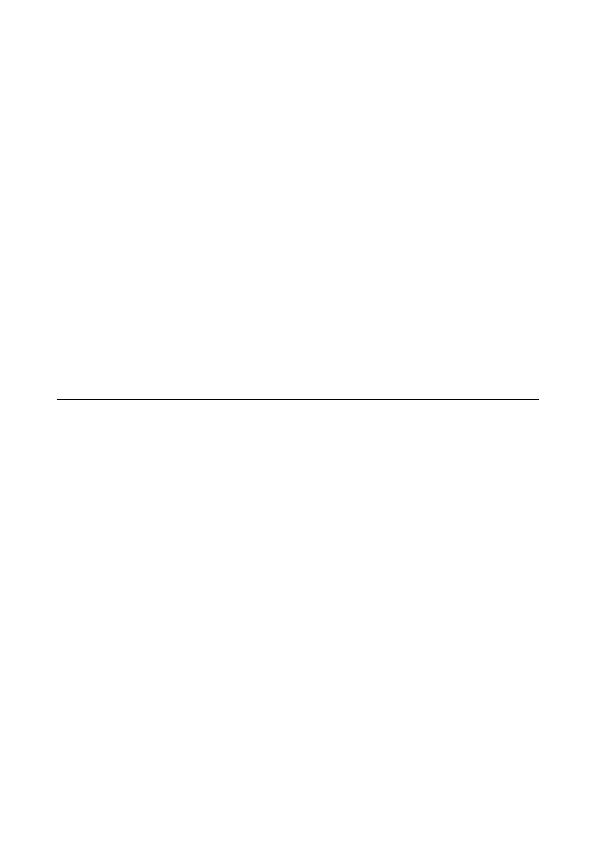
schémas de l'activité dans les régions du cerveau) issus de
l'imagerie cérébrale ne pourraientils pas être utilisés pour
mesurer directement l'intensité de la douleur? Et ces tech
niques ne pourraientelles pas permettre de comparer les
traitements de la douleur?
Tor Wager (University of Colorado) et ses collègues ont
réalisé quatre études sur un total de 114 personnes, dans
l'objectif de développer un modèle basé sur l'IRMf capable
de prédire l'intensité de la douleur au niveau individuel.
Dans la première étude, le schéma neurologique a montré
une sensibilité et une spécificité de 94% ou plus pour la dis
tinction entre la sensation de chaleur douloureuse et non
douloureuse. Dans la deuxième étude, la sensibilité et la
spécificité étaient de 93%. La troisième étude a établi une
distinction entre douleur physique et la douleur sociale,
avec une sensibilité de 85% et une spécificité de 73%. La
quatrième a permis d'observer un signal significativement
moins fort après administration de rémifentanil.
pour objectiver la douleur causée par la chaleur chez les
personnes saines. Ils soulignent également que des études
complémentaires devront être menées pour savoir si le
schéma neurologique obtenu par IRMf peut permettre de
prédire la douleur clinique. La classification de la douleur
pourrait être moins précise chez les patients que chez les
personnes saines. Dans la mesure où il est possible que les
schémas IRMf associés à la douleur diffèrent selon la loca
lisation dans l'organisme, le type de douleur ou la cause cli
nique, il pourrait être nécessaire de développer plusieurs
schémas. Il reste donc encore beaucoup de chemin à par
courir. Les auteurs estiment néanmoins avoir franchi une
étape vers le développement de schémas neurologiques
pertinents pour l'objectivation de différents types de dou
leur et d'autres processus cognitifs ou affectifs.
autologue non sélectionné permet d'obtenir une amélioration durable de l'épaisseur cutanée et de la capacité
vitale forcée chez les patients atteints de sclérodermie. Pour la première fois, des chercheurs ont démontré la
valeur ajoutée d'un dépistage cardiaque approfondi préalable à la transplantation pour mieux estimer le risque lié
au traitement dans cette population. L'article a été publié par Richard Burt et al. dans The Lancet.
une maladie autoimmune qui s'accompagne d'une vas
culopathie diffuse, d'une activation immunitaire et d'une
fibrose tissulaire, n'a pas d'impact sur la progression de la
maladie. Plusieurs études non randomisées sur de petits
nombres de patients suggèrent que la TCSH exerce un ef
fet favorable sur la peau et la capacité vitale. Le seul essai
randomisé disponible a montré que la TCSH autologue
améliorait effectivement l'aspect cutané et la capacité vi
tale forcée, tandis qu'une progression était observée chez
des patients sous traitement standard avec administration
intraveineuse mensuelle de cyclophosphamide. Plusieurs
essais sur des transplantations dans des cas de sclérose
systémique ont été compliqués par la mortalité liée au trai
tement (jusqu'à 10%). Pour le cancer et les maladies auto
immunes, dont la sclérose systémique, les recommanda
tions préconisent de réaliser un échocardiogramme afin
de s'assurer que le coeur peut supporter la transplantation.
susceptibles de bénéficier d'une TCSH, les problèmes car
diaques constituent une cause de mortalité thérapeutique
connue dans la sclérose systémique.
Richard Burt et son équipe ont analysé les résultats de
deux centres qui avaient eu recours à la même TCSH non
myéloablative, sans sélection ni manipulation du greffon
sanguin. Leur objectif était de mieux identifier les causes
de la mortalité liée au traitement et de déterminer si la
fonction cardiaque de départ avait un effet sur le résultat.
Ils ont également cherché à définir la méthode de dépis
tage optimale en vue de la transplantation pour éviter de
sélectionner des patients présentant une réserve cardiaque
insuffisante et incapables de bien tolérer la procédure.
Cinq patients sur 90 (6%) sont décédés de cause liée au
traitement, dont quatre à la suite de complications cardio
vasculaires. La survie était de 78% après 5 ans et la sur
vie sans rechute de 70% après 5 ans. Les auteurs ont
J med 2013;368:1388-97.