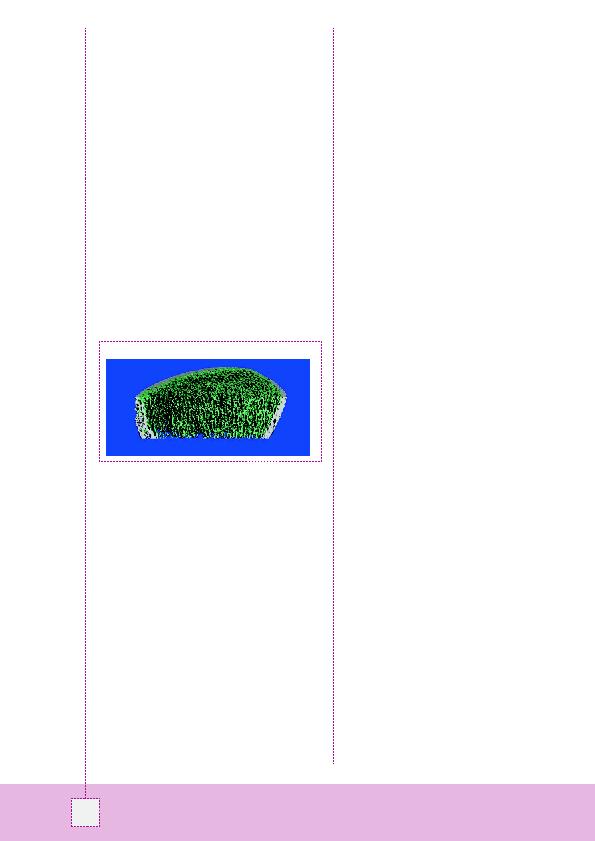
ainsi que la surface moyenne de l'os (CSA) sont réellement
mesurés. Les autres paramètres sont calculés.
De récentes améliorations permettent également, par une
définition plus adéquate de l'os cortical, de quantifier la
porosité corticale.
Il est par ailleurs possible, à partir des images en haute ré-
solution obtenues, de réaliser des analyses en éléments finis
(méthode issue de la mathématique et de l'informatique,
utilisée pour les crash tests automobiles, par exemple) afin
d'estimer les propriétés mécaniques de l'os imagé.
La reproductibilité des mesures de densité est comparable
à celle observée avec la DXA, avec des coefficients de
variation (CV) autour de 1%, alors que les mesures archi-
tecturales ont des CV d'environ 3% (1).
une aide conséquente dans l'évaluation du risque fractu-
raire qui se voit améliorée par la différentiation de la den-
sité minérale corticale et celle de l'os trabéculaire et par
la mesure des différents paramètres microarchitecturaux
(
perte osseuse commence dans le compartiment trabécu-
laire chez les adultes jeunes le tiers de la perte osseuse
totale survenant avant l'âge de 50 ans alors que la perte
corticale survient plus tardivement. La diminution du vo-
lume trabéculaire osseux est similaire dans les deux sexes.
On retrouve cependant, au HR-pQCT, des différences ar-
chitecturales: essentiellement perte de travées osseuses et
donc perte de connectivité chez la femme, amincissement
des travées chez l'homme. De même, dans le comparti-
ment cortical, la perte osseuse évaluée par microscanner
périphérique commence dès la ménopause chez la femme,
alors qu'elle ne devient significative qu'à partir de 75 ans
chez l'homme (2, 3). Observations qui pourraient expliquer
en partie la prépondérance des fractures ostéoporotiques
chez la femme.
l'HR-pQCT analyse cas-témoin nichée au sein d'une
détermination de la microarchitecture trabéculaire et cor-
ticale au radius distal permet de différencier, indépendam-
ment de la DMO surfacique mesurée par DXA (DMOs), les
femmes ostéopéniques ayant présenté une fracture (101
femmes) de celles sans antécédent fracturaire (1). Dans
une autre étude cas-témoins, les femmes ayant une frac-
ture de l'extrémité supérieure du fémur présentaient une
altération de la microarchitecture trabéculaire et corticale
par rapport aux témoins (4). Ces études démontrent éga-
lement que les paramètres de microarchitecture trabécu-
laire mesurés chez les femmes ostéopéniques fracturées
tendent à être similaires à ceux des femmes présentant
une ostéoporose avérée selon la définition de l'OMS.
distaux permet de distinguer la sévérité des fractures ver-
tébrales, indépendamment de la DMOs mesurée au niveau
du rachis altérations d'autant plus importantes au ni-
veau de l'os cortical que les fractures vertébrales préva-
lentes étaient sévères et multiples (5, 6).
Dans une analyse transversale de la cohorte masculine
STRAMBO, les fractures vertébrales et leur sévérité étaient
également associées aux modifications de la microarchi-
tecture (7).
Chez l'homme, pourtant moins sujet à l'ostéoporose, il a
été démontré que les mêmes mesures étaient tout aussi
pertinentes. Les résultats étaient associés aux fractures
ostéoporotiques de toutes sortes, dont les fractures
vertébrales (8).
en éléments finis, des différences significatives entre les
paramètres biomécaniques mesurés au radius et au tibia
distaux de patientes ayant eu une fracture par fragilité
et leurs témoins appariées pour l'âge, de façon partielle-
ment indépendante de la DMOs au radius ultradistal ou à
la hanche; pour les fractures du poignet dans un premier
temps (9) puis pour tous types de fractures (10).
mations sur la fragilité osseuse, non capturées par les me-
sures de DMO ou de microstructure usuelles: elle a ainsi
permis de montrer que, au poignet, l'essentiel de la charge
est portée par l'os cortical (
des fractures.
microarchitecturales observées en périphérique, ainsi que
les variables mécaniques, avec les fractures situées à des
sites distants des sites osseux distaux mesurés.
mesure au tibia semble meilleure qu'au radius, peut-être
du fait des artéfacts de mouvements observés au niveau
radial, et du caractère porteur du tibia.