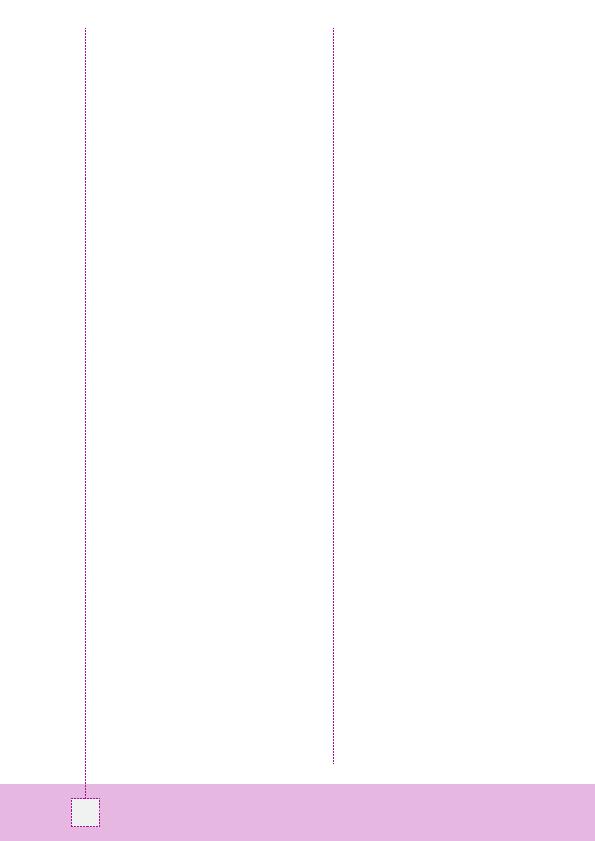
ment systémique après une récidive de CSTN. La maladie
étant actuellement incurable, ce traitement palliatif a
également un autre objectif, à savoir prolonger la survie
et retarder/traiter les symptômes. Bien que la chimiosen-
sibilité soit souvent élevée en phase adjuvante (cf. taux
élevé de RPC), ce sont surtout les tumeurs peu chimio-
sensibles qui récidivent. La réponse (et donc le pronostic)
en phase métastatique est généralement décevante (75,
99). Aucun schéma n'est supérieur à un autre. Lorsqu'une
réponse rapide est nécessaire (par ex. en cas de crise
viscérale), on peut avoir recours à une monochimio-
thérapie ou une chimiothérapie combinée, notamment
à base d'anthracyclines (doxorubicine, épirubicine, etc.),
de taxanes (paclitaxel, docétaxel, etc.), d'antimétabolites
(capécitabine, gemcitabine) et autres inhibiteurs et/ou
stabilisateurs des microtubules (vinorelbine, éribuline, ixa-
bépilone). Les schémas à base de platine (cisplatine, carbo-
platine) sont séduisants sur papier (cf. supra), mais dans
la pratique, les résultats obtenus sont plutôt moyens (10-
30% de réponse, quel que soit le sous-type de cancer du
sein) (113-115). Les schémas combinés paclitaxel + gem-
citabine et docétaxel + capécitabine sont efficaces chez les
patientes qui ont reçu des schémas à base d'anthracyclines
auparavant (116, 117). L'adjonction d'ixabépilone à la ca-
pécitabine augmente la réponse et la survie sans progres-
sion, y compris en cas de CSTN (118, 119).
été étudiés comme cibles thérapeutiques potentielles dans
le cadre du CSTN. Cependant, le manque de biomarqueurs
prédictifs limite l'utilité des traitements qui les visent. À ti-
tre d'exemples, citons le VEGF (
PARP (poly(ADP-ribose) polymérase), l'EGFR (
lian Target Of Rapamycin), Src, les HDAC (histones déacé-
tylases) et les récepteurs androgéniques.
du CSTN n'est toujours pas clair. Malgré les propriétés pro-
nostiques du VEGF ainsi que l'augmentation de la survie
sans progression et du taux de réponse, aucune améliora-
tion de la survie globale n'a été constatée dans les études
de phase III (E2100, AVADO, RIBBON-1) réalisées avec le
bévacizumab (un anticorps monoclonal humanisé dirigé
contre le VEGF) (120-122). Ces résultats ont conduit la
FDA (
(123). Les données relatives à une éventuelle augmenta-
tion du taux de RPC en phase néoadjuvante ne sont pas
univoques. Par contre, il y a bel et bien une hausse de la
toxicité et des coûts (124-126). Nous attendons les résul-
sée avec le bévacizumab en phase adjuvante dans le cadre
du CSTN (127).
sants dans le cadre des CSTN, puisque ces tumeurs présen-
tent souvent des anomalies fonctionnelles au niveau des
gènes BRCA (réparation de l'ADN), indépendamment de la
présence de mutations de BRCA1 ou 2 (cf. supra). PARP
est impliqué dans différents mécanismes de réparation de
l'ADN, ainsi que dans la croissance tumorale. L'activité de
PARP augmente sous l'impulsion de dommages à l'ADN
causés par la radiothérapie et la chimiothérapie (128, 129).
Ces effets font des inhibiteurs de PARP des agents chi-
miosensibilisateurs et radiosensibilisateurs intéressants,
capables d'induire des ruptures létales d'ADN qui ne peu-
vent pas être réparées dans les cellules tumorales «BRCA-
déficientes», entraînant la mort de ces cellules. Différents
inhibiteurs de PARP en cours de développement (par ex.
olaparib, véliparib) ont montré des résultats prometteurs
dans le cadre du cancer du sein associé à BRCA1/2 (in-
dépendamment du sous-type), mais, pour l'instant, pas
chez des patientes non sélectionnées atteintes d'un CSTN
non lié à BRCA (130-135). Même si une étude de phase II
réalisée avec l'iniparib a révélé un prolongement de la sur-
vie globale et sans progression avec un minimum de toxi-
cité, ces résultats n'ont pas été confirmés dans le cadre
d'une étude de phase III de plus grande envergure (134).
Des problèmes méthodologiques ont été invoqués, mais
l'hétérogénéité et la complexité moléculaires du CSTN y
sont peut-être aussi pour quelque chose (102, 136).
une surexpression d'EGFR/HER1, un récepteur qui joue un
rôle majeur dans la prolifération, la migration et la résis-
tance à l'apoptose (22, 29, 72, 137). Un sous-groupe de
CSTN et de cancers du sein de type
mie du chromosome 7. Les anticorps monoclonaux anti-
EGFR1 n'ont toutefois qu'une activité limitée ou clinique-
ment peu significative (cetuximab) (138-140). Ici aussi, il
importe de développer des biomarqueurs permettant de
garantir une bonne sélection des patientes chez qui ce
traitement sera efficace.
histones déacétylases (HDAC) sont d'autres pistes actuel-
lement à l'étude. mTOR est une molécule effectrice de la
voie PTEN/AKT/IP3K, laquelle est souvent dérégulée dans
le cancer du sein. Cette molécule peut être inhibée à l'aide
de l'évérolimus (141). Surexprimées dans le CSTN