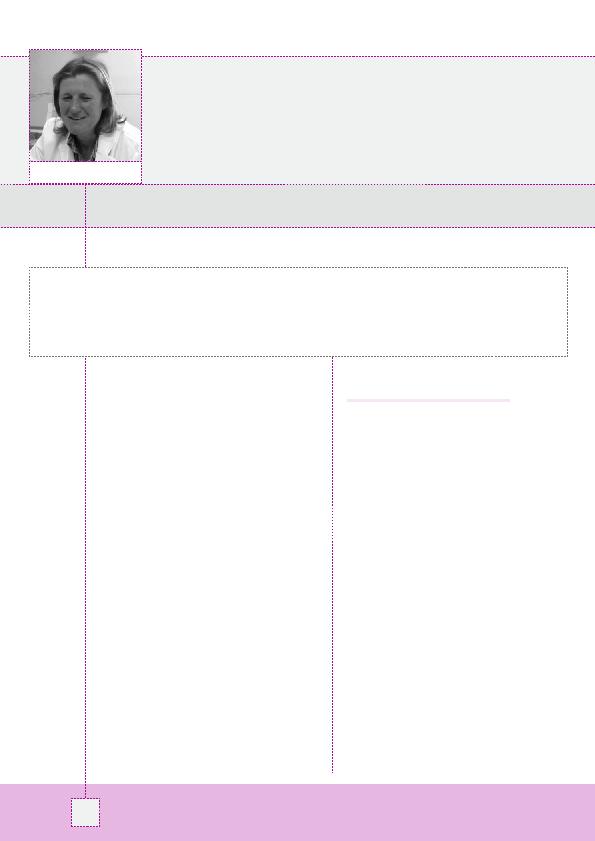
0F
flammatoire, mais on ne sait pas encore s'il s'agit de la
cause ou de la conséquence. L'élément-clé est cependant
la prostaglandine E2 (PGE2). Celle-ci exerce de nombreux
rôles tant physiologiques que pathologiques et est un
facteur important dans le développement de l'endomé-
triose. La PGE2 régule notamment la prolifération cellu-
laire, exerce un effet anti-apoptotique, intervient dans la
suppression immunitaire et promeut l'angiogenèse lors du
développement de l'endométriose.
cyclo-oxygénases (COX). La COX-1 est constitutive, alors
que la COX-2 est induite par de nombreux facteurs pro-
inflammatoires comme les cytokines ou les interférons. La
COX-2 est fortement exprimée dans les tissus endométrio-
siques. Il en résulte de fortes concentrations péritonéales
de PGE2 chez les patientes avec endométriose. La COX-2
stimule aussi l'aromatase qui, en retour, va stimuler cette
cyclo-oxygénase et donc créer un cercle positif.
tonéales que dans le tissu glandulaire et le tissu stromal.
C'est pour cette raison que l'on peut tenter d'inhiber
l'inflammation par des anti-COX2 ou des AINS. Il existe
également de nombreuses voies intermédiaires qui ont
conduit certaines équipes à travailler à la mise au point de
thérapies ciblées. Mais on est encore loin d'y arriver sans
effets secondaires.
on dispose actuellement, à côté de l'examen clinique, de
l'échographie, de l'IRM et de la laparoscopie diagnostique.
Mais la recherche se dirige aussi vers divers marqueurs
plasmatiques ou endométriaux. La prostaglandine pour-
rait être l'un de ceux-ci, puisqu'elle est fortement aug-
mentée dans les prélèvements endométriaux de femmes
avec endométriose.
ont de l'endométriose et d'autres non, alors que le reflux
menstruel se retrouve chez quasi toutes les femmes. Cette
«inégalité» trouve probablement son fondement dans
l'immunité cellulaire et locale qui interagit avec les phé-
nomènes inflammatoires sous-jacents. Et cette inégalité
se traduit par un problème d'équilibre entre la greffe (la
cellule endométriale qui est probablement différente chez
la femme endométriotique) et le sol (le péritoine y est pro-
bablement plus réceptif)...
taines ne sont en effet découvertes que fortuitement,
à l'occasion par exemple d'une ligature tubaire. Elles se
situent à la limite du physiologique. D'autres peuvent être
très sévères, sans qu'il y ait nécessairement gradation de
l'une vers l'autre avec le temps.
en âge de reproduction avec douleurs pelviennes chroniques, l'endométriose peut être considérée comme une
maladie inflammatoire locale présentant une réponse immunitaire péritonéale aberrante. Les cellules endométriales
inflammatoires pour promouvoir leur croissance, l'angiogenèse et la progression de la maladie au sein de la cavité péritonéale.
Résumé d'une pathologie qui recèle encore de nombreux mystères avec Aude Béliard (CHU Bois de l'Abbaye, Seraing).