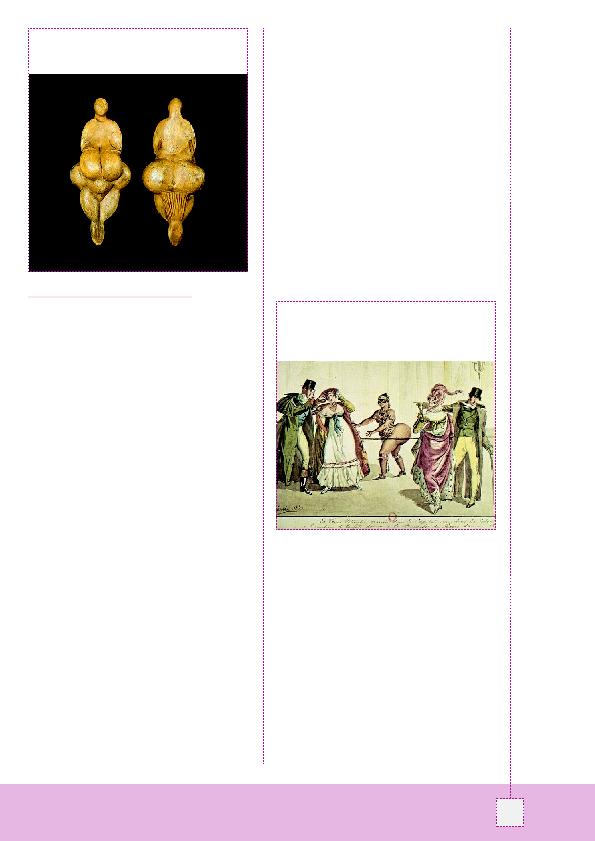
généreux à ne pas confondre avec la «callipygie», qui fait
référence à un exemplaire (particulièrement) esthétique.
D'aucuns ont voulu voir un lien entre les rondeurs fémi-
nines des Vénus préhistoriques et la stéatopygie observée
chez les peuplades les plus primitives d'un point de vue gé-
nétique (Khoi)san, Bochimans, Hottentots, Bornou, Ewe,
Konde, Pygmées...
Cette hypertrophie fessière, considérée comme caractéris-
tique de certaines races noires (en particulier les Bochimans
et les Hottentots), a toujours beaucoup intrigué les Euro-
péens. Pathologique chez les femmes caucasiennes, ce trait
relève dans certaines peuplades noires d'une simple parti-
cularité ethnique. Chez les San, le tissu adipeux s'accumule
non seulement au niveau des fesses proprement dites, mais
aussi au-dessus des os de la région pubienne et surtout des
trochanters (
anatomique les uns défendant la thèse d'un déterminisme
naturel et racial, les autres une explication d'ordre plus
socio-culturel.
C'est ainsi que les scientifiques ont élaboré au départ de
cette partie bien spécifique du corps de la femme de véri-
tables théories sur les races, voire sur l'espèce humaine
toute entière. Pour eux, l'attrait «scientifiquement établi» de
la stéatopygie et la focalisation du regard médical sur cette
zone très sexualisée témoignait clairement de la nature de
l'intérêt que les hommes africains portaient à la femme.
À mi-chemin entre l'image de la créature hypersexua-
lisée aux organes sexuels exubérants et celle du monstre
grotesque aux formes improbables, le corps de la femme
africaine suscitait chez les médecins occidentaux un inté-
rêt mêlé de crainte, mais aussi d'une certaine fascination.
Installés au bureau de leur cabinet européen ou dans un
dispensaire de brousse, ils ont été nombreux à coucher sur
menter les mythes et légendes locaux avec une connais-
sance plus ou (souvent) moins pointue de la réalité du
Continent noir.
Au vu du nombre de descriptions qu'ils leur ont consacrées,
les fesses généreuses des Africaines étaient clairement l'élé-
ment qui a le plus retenu leur attention.
1816), une femme sud-africaine issue de l'ethnie Khoisan,
qui a été exposée aux regards des curieux à Londres en
1810-11, puis à Paris en 1815 (
un véritable symbole des théories racistes, puisqu'il «confir-
mait» que son ethnie était, dans la théorie de l'évolution,
l'une des plus primitives.
au
génocide commis par les Allemands en Namibie deve-
nant dans le même temps des «artéfacts» ethnologiques
très recherchés. La vision primitive de ce peuple telle
qu'elle existait dans les années 1860-70 était pleinement
acceptée par les sphères anthropologiques anti-darwi-
nistes autrichiennes. Elle reposait sur l'opposition primaire
entre la «sauvagerie» (considérée comme un synonyme de
l'immoralité) et la culture (chrétienne), niant complète-
ment la théorie beaucoup plus libérale du processus de
civilisation. Les mesures anthropométriques furent pous-
sées à leur comble par les anatomistes et biologistes de
l'époque, qui n'hésitaient pas à en tirer des conclusions
exagérées. On en trouve un bon exemple chez Cuvier (3)
et Montandon (4), qui affirme que
prochent le plus de la brute, et dont l'intelligence ne s'est
de l'
présentation à Paris:
donnée à la Duchesse de Berri l'année 1815.