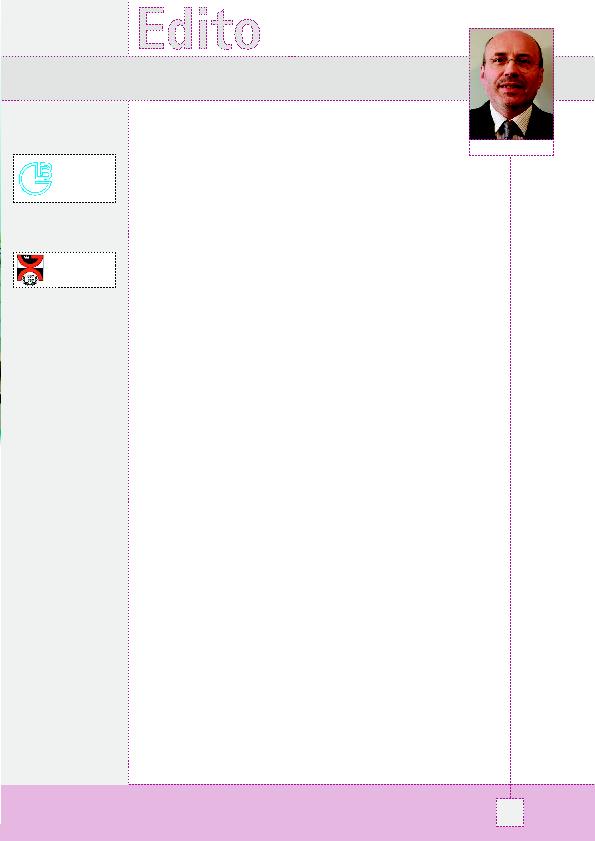
de Gynécologie
et d'Obstétrique
budgets ministériels ont été récemment alloués (1). Déjà en 1990, Reiter soulignait que la douleur
pelvienne chronique concerne 10% des motifs de consultation chez le gynécologue, 20% des procédures
laparoscopiques et 18% des causes d'hystérectomie (2).
similaires à celles de la lombalgie chronique (3, 4), une approche multidisciplinaire sur le modèle de la
clinique ou de l'école du dos ne serait-elle pas l'avenir?
L'intensité de la douleur, sa durée, sa récurrence, son impact sur l'activité quotidienne, sur l'activité
sexuelle et sur l'absentéisme au travail permettent d'appréhender le retentissement du symptôme sur
la qualité de la vie de ces femmes.
également le syndrome de congestion pelvienne, les séquelles obstétricales et chirurgicales, ou encore
les causes neuromusculaires. D'autres pathologies intriquées agissent comme des catalyseurs de la
douleur: les causes gastro-entérologiques, urologiques, rhumatologiques. De plus, l'expression de la
douleur peut être très variable et apparaître discordante par rapport à la sévérité de la pathologie
organique sous jacente. L'approche culturelle et sociale de la douleur modifie également son expression
et son acceptation.
gynécologique complet, élargi au pelvis, et des imageries complémentaires ciblées (échographie, IRM).
adéquat car la chronicité algique induit des mécanismes psycho-physiologiques complexes expliquant
que la douleur puisse perdurer malgré le traitement de la pathologie organique initiale. Le motif de la
consultation ne serait plus dicté par le rythme des épisodes douloureux, mais par la progression de la
démarche diagnostique et thérapeutique, afin de reconnaître et traiter les effets toxiques de la douleur
«bruit de fond» et de prévenir la survenue d'épisodes aigus.
sur la qualité de la vie des femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques, la multidisciplinarité de
la prise en charge (gynécologues, psychologues, kinésithérapeutes,...) semble s'imposer.
multidisciplinaire afin de mettre tous les moyens efficaces à disposition. Ce modèle pluridisciplinaire a
déjà fait ses preuves dans d'autres pathologies douloureuses chroniques: ne serait-il pas à encourager
dans les pathologies pelviennes chroniques? Tel me semble être l'enjeu de cette rentrée d'octobre au
symposium du GGOLFB réunissant comme orateurs gynécologues, urologue, psychiatre sexologue,
neurologue et anesthésiste.
1.