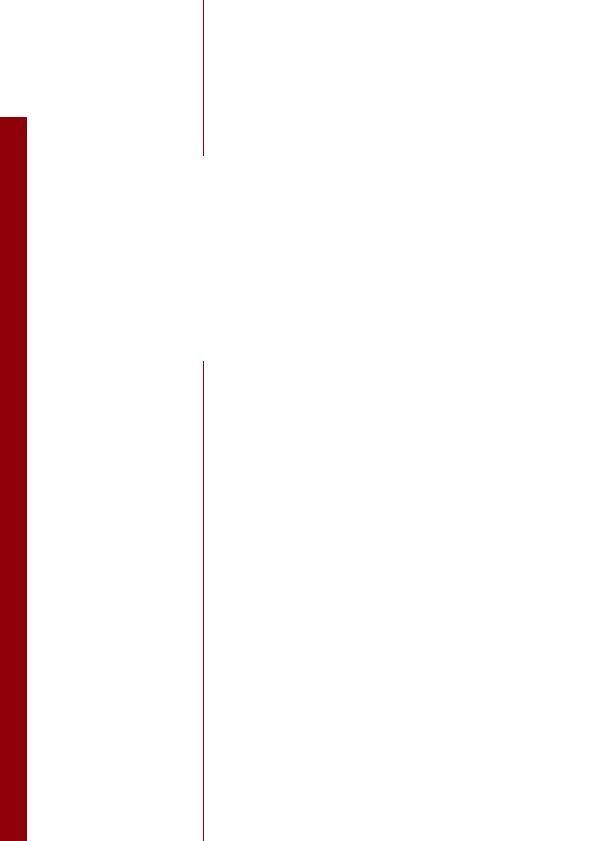
la dépendance à l'alcool? En d'autres termes, devons-nous nous focaliser sur les 15
millions de personnes dépendantes à l'alcool dans l'Union européenne, et pour
lesquelles on sait que 10% seulement bénéficient d'un traitement (les 2/3 rechutent
endéans les 12 mois)? Ou devons-nous étendre nos préoccupations?» Cette question,
posée par Philip Gorwood, mérite réflexion car il n'y a pas que la dépendance en
elle-même, mais aussi les effets toxiques généraux de l'alcool (2). Or peu de patients
recourent aux soins dans cette situation, comme l'ont démontré deux études récentes
aux résultats semblables: 7,0-7,3% des patients avec problèmes liés à l'alcool ont eu
recours à des soins (3). «Il nous faut donc modifier la manière de détecter ces patients
et de les traiter», poursuit le spécialiste parisien.
abstinents après 12 mois de traitement et que 2/3 des patients traités par naltrexone
ont rechuté au moins un jour, et de manière conséquente, au cours des 16 semaines
de traitement, on sait aussi que l'obtention d'une rémission à 12 mois garantit une
rémission complète à 85,7% d'entre eux après 3 ans (5,1% de rechutes). Mais des
études récentes ont également montré que la réduction de la consommation d'alcool
est un pas important et plus sûr vers l'abstinence (5), celle-ci devenant plutôt un
objectif de seconde intention, «un concept que les rédacteurs du DSM-5 ont largement
avalisé», poursuit Gorwood.
C'est dans ce cadre qu'il faut accueillir le constat que la motivation à l'arrêt à travers des
informations spécifiques permet de réduire de manière substantielle la consommation,
et donc le risque (7). La substitution est l'un de ces outils, un outil qui a fait ses preuves
dans d'autres pathologies addictives: l'utilisation de méthadone réduit en effet non seu-