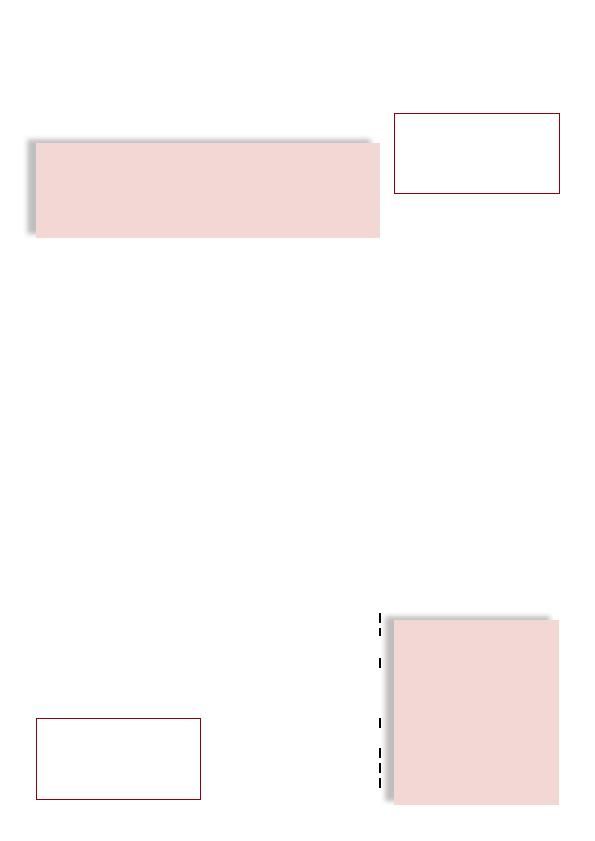
45% des patients à 10 ans, surtout en si-
tuation temporale, mais les résultats sont
moins bons en extratemporal, surtout
pour la région frontale.
de vie, comment tenter de
résoudre nos problèmes
moraux?
année à un exposé du Pr P. Le Coz, agré-
gé de philosophie de la Faculté de Mé-
decine d'Aix-Marseille, président par
ailleurs du Comité de Déontologie de
l'Autorité sanitaire française. Le sujet de
sa conférence abordait l'éthique en fin
de vie, en essayant de donner des
conseils pour résoudre les dilemmes mo-
raux des médecins dans le contexte de la
fin de vie. Il a commencé par rappeler la
loi française, dite Léonetti, datant de
2005 et concernant la fin de vie. Cette
loi est une protection contre des actes
déraisonnables en fin de vie, par exemple
d'acharnement, mais n'aborde pas clai-
rement l'euthanasie. Cependant, il est
clair que cette loi nécessite d'être modi-
fiée en raison du nombre de plus en plus
important de problèmes de fin de vie, du
à l'augmentation continuelle de l'espé-
rance de vie et, dès lors, du nombre de
patients démontrant des pathologies du
vieillissement posant parfois la question
de l'euthanasie.
contré généralement par le médecin de-
vant le pronostic sombre d'une patholo-
gie. Il décrit à ce moment un conflit de
valeurs qui peut être un facteur angois-
comme seule solution qu'une certaine
agressivité pour «détruire son angoisse».
Ce conflit se situe entre deux opposés.
D'une part, une attitude de franchise et
de loyauté qui a le mérite de la clarté,
mais qui est parfois reconnue comme
malfaisante car la réalité brutale, trop
détaillée, peut engendrer chez le patient
une réaction catastrophique avec an-
goisse, dépression... Le médecin ressent
donc cette peur de faire souffrir. D'autre
part, avoir une attitude lénifiante, bien-
faisante, conventionnelle peut entraîner
chez le médecin la crainte du méconten-
tement du patient lorsque celui-ci, d'une
manière ou d'une autre, apprendrait la
réalité et pourrait reprocher au médecin
de l'avoir «trompé»!
Pour aider le médecin à trouver «son
chemin» dans ce conflit de valeurs,
l'orateur propose de choisir le moment
opportun, ou «kairos», pour communi-
quer avec le patient: plutôt que de lui
annoncer brutalement une mauvaise
nouvelle, il faut profiter de la conversa-
tion pour faire passer le message dans le
processus de la conversation, c'est-à-
dire «de biais et non frontalement».
ou contre l'euthanasie en mettant en évi-
dence sur le plan philosophique deux
attitudes de pensées opposées: d'une
part, la déontologie, dont le représentant
est l'Allemand Immanuel Kant (1724-
représentant est l'Anglais J. Penthan
(1748-1832).
la dignité, la loyauté, l'équité et l'auto-
nomie du patient. Elle se base donc sur
le devoir («deon-ontos» = ce qu'il faut
faire réellement) et le discours («logos»)
du médecin avec «interdiction» de don-
ner la mort, ce qui, dans certains cas,
peut être facteur de créativité pour trou-
ver d'autres solutions.
À l'opposé, l'utilitarisme cherche le plus
grand bonheur du plus grand nombre,
donc de la collectivité, et donne le droit
au patient de demander à mourir, c'est-
à-dire le droit de ne pas souffrir.
et de l'autre, le droit du patient. Com-
ment s'en sortir? Il reprend alors les
quatre principes éthiques d'autonomie,
de bienfaisance, de non-malfaisance et
de justice (équité), le premier et le qua-
trième rentrant dans le cadre de l'atti-
tude déontologique, le deuxième et le
troisième dans le cadre de l'attitude utili-
tariste, ce qui met dos à dos les principes
éthiques dans ce contexte. Finalement,
maux qui nous donne le
plus d'horreur.»
opportun (kairos)»
propose de choisir le moment