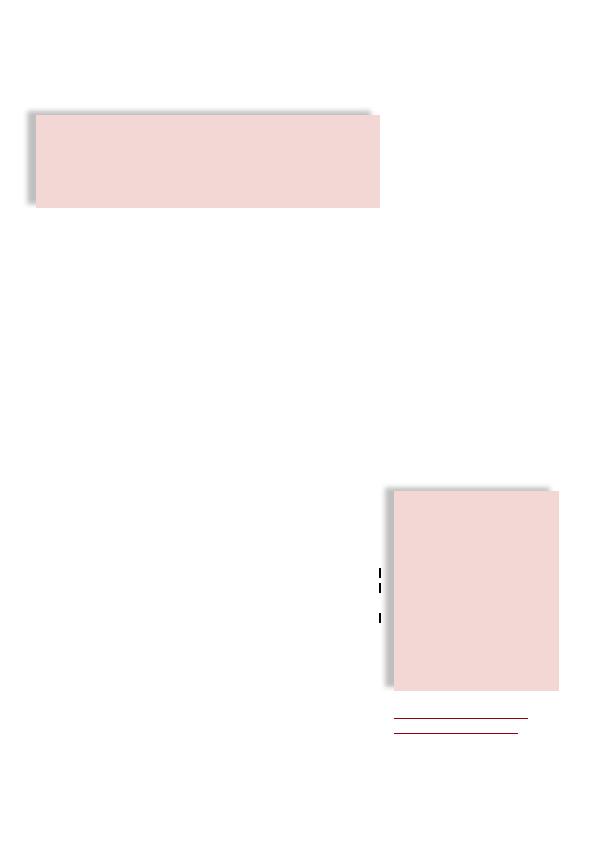
l'adulte. Cependant, il existe des
risques lors du sevrage des antiépilep-
de classe I (contrôlée, randomisée),
émane de Lossius (9) et a été réalisée
en 2008 en Norvège (dans la région
d'Akerchus), où les auteurs ont pu no-
ter, après un an de suivi, un taux de 7%
de récidive dans le groupe où le traite-
ment avait été maintenu et suivi et 15%
de récidive dans le groupe où les pa-
tients avaient vu leur traitement anti-
épileptique progressivement stoppé,
compte tenu cependant de critères
d'exclusion comme une polythérapie
antiépileptique ou une épilepsie juvé-
nile myoclonique (RR 2,46; 95% CI:
0,85-7,08; p = 0,095). Le sevrage n'a
pas entraîné de modification significa-
tive de la qualité de vie et de l'EEG. Les
facteurs prédictifs favorables étaient un
examen neurologique normal et le trai-
tement par carbamazépine.
De manière plus générale, et dans des
études de moindre qualité, on note que
l'arrêt des antiépileptiques peut entraî-
ner, dans toutes les formes d'épilepsie,
une récidive dans 25% des cas à 1 an et
29% à 2 ans, d'après, entre autres, la
méta-analyse de Berg (10). Ce risque de
récidive est particulièrement plus élevé
pour les épilepsies commencées à l'âge
adulte que pour les épilepsies infantiles
(11).
américaine de Neurologie reprenaient
les conditions suivantes pour envisager
un sevrage de traitement antiépileptique:
2 à 5 ans sans crise, un patient ne souf-
frant que d'un seul type de crise épilep-
normal, et un électroencéphalogramme
normal.
dues au sevrage est donc particulière-
ment élevé lorsque:
cence plutôt que dans l'enfance;
symptomatique;
de crises chez un même patient;
et/ou myocloniques;
d'obtenir le contrôle des crises par
le traitement médicamenteux;
tiales ont été mauvaises ou, en tout
cas, plus de 5 crises par an ont été
observées en cours d'évolution;
mal.
sieurs facteurs de risque potentialise le
risque de sevrage. Par contre, l'orateur
signale comme facteurs favorables:
l'enfance;
cace;
mazépine (10);
mal.
que:
une forme d'épilepsie pour laquelle
la rémission spontanée est la règle
(12);
une tendance fréquente à la rémis-
sion spontanée (12);
juvénile ne démontre pas habituel-
lement de rémission et est au
contraire
des auteurs.
rêter ou non un traitement antiépilep-
tique doit être prise en concertation avec
le patient en fonction de divers facteurs
psychosociaux, dont un refus irrationnel
d'arrêter par peur de perdre le bénéfice
du traitement. Il faut également tenir
compte d'aspects professionnels comme
la conduite automobile. Quant à la du-
rée du sevrage progressif, il n'y a pas de
différence dans les résultats entre un se-
vrage s'étalant sur 1 ou 9 mois, ceci du
moins chez l'enfant car, chez l'adulte, il
n'y a pas de données sur ce point.
focales et leur pronostic
leptogènes focales et à leurs facteurs
pronostiques. Il faut d'abord rappeler
que la pharmacorésistance concerne