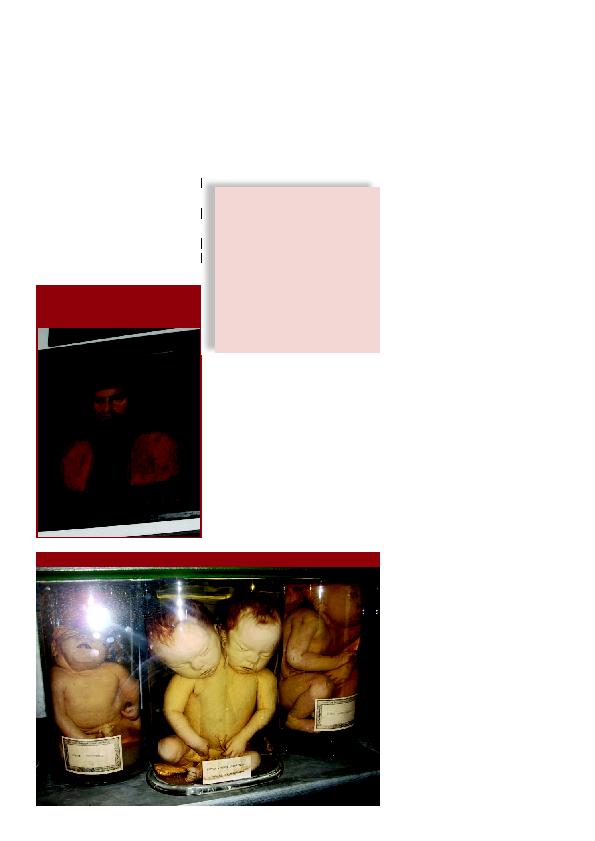
1553) (Photo 3)! Il s'y trouve encore un
musée d'anatomie très intéressant dans
la mesure où des pièces anatomiques
conservées dans le formol (Photo 4), des
coupes, des moulages, des statuettes en
cire et des squelettes très explicites y
sont conservés de longue date pour être
consultés au besoin. En effet, certaines
pièces concernent des pathologies an-
ciennes devenues rares aujourd'hui et
sont donc des références utiles. Cer-
taines pièces relèvent de la névrologie
(Photo 5), branche de l'anatomie traitant
confondre avec la neurologie, terme
créé par le londonien Thomas Willis
(1621-1675) pour dénommer la disci-
pline médicale clinique qui étudie l'en-
semble des maladies du système ner-
veux.
tous azimuts
se sont déployés dans de nombreuses
salles où diverses thématiques ont été
abordées par les sociétés scientifiques
concernées, comme le Club franco-
phone de Sclérose en plaques, la Ligue
française contre l'Épilepsie, la Société
française de Neurologie, l'Association
française, la Société française de Méde-
cine physique et de Réadaptation, le
Club des Mouvements Anormaux
(CMA)...
réunion de la Ligue française contre
l'Épilepsie, consacrée aux facteurs de
risque de récidive après arrêt du traite-
ment antiépileptique, et la réunion, tra-
ditionnellement très suivie, du CMA.
plus de 400 pour 2.300 inscriptions au
congrès (1 neurologue sur 5 vient donc
avec une communication affichée). Glo-
balement, il y avait moins de travaux
belges que d'habitude, mais beaucoup
de communications émanant de pays
africains et particulièrement du Ma-
ghreb. Ces posters comportent encore
quelques «case reports», mais consistent
de plus en plus en l'analyse de petites,
voire de moyennes, séries de patients
avec des pathologies centrales diverses
(extrapyramidales, vasculaires...) ou en-
core périphériques. Nous mettons en
exergue la présentation défendue par
P.Y. Libois (Charleroi) (Photo 6) concer-
nant le contrôle par actimètre de l'obser-
vance de la thérapie par contrainte in-
duite de l'hémiplégie. La quantification
des mouvements côté sain versus côté
lésé est corrélée aux résultats des évolu-
tions motrices et fonctionnelles. L'acti-
mètre se révèle être un nouvel outil
simple dans la prise en charge de l'hémi-
plégie et pourrait ainsi déterminer le ni-
veau minimum utile d'observance de la
contrainte de mouvements (1).
le premier était présenté par Riahi et al.
(Tunis) et montrait 5 patients diabétiques
(de 56 à 85 ans) avec un hémiballisme
soudain et secondaire à une hyperglycé-
mie sans cétose. On y observe des lé-
sions spontanément hyperdenses du
striatum (pallidum et noyau caudé) au
sur le mur de la salle des professeurs,
à l'Université de Montpellier.