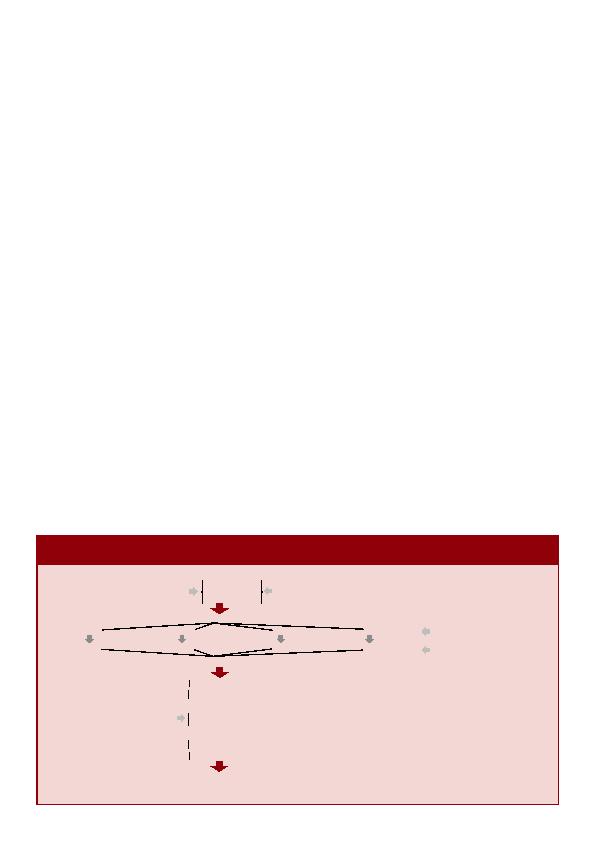
réler les mutations avec les taux de pro-
téines A1-42 et tau (t-tau et p-tau181)
dans le sang, le liquide céphalorachidien
(LCR) et le cerveau, permettant ainsi de
démontrer si ces mutations exercent un
effet sur les processus de la maladie. Des
études ont par exemple permis de dé-
couvrir que les polymorphismes CR1 in-
hérents à la MA sont associés à une aug-
mentation de la quantité de protéines
A1-42 dans le LCR (25) (Figure 2).
Une troisième manière d'obtenir un
complément d'informations sur les pro-
cessus sous-jacents de la maladie est de
corréler les mutations génétiques avec
des facteurs endophénotypiques [tels
que des données d'imagerie neurolo-
gique, l'âge lors de l'apparition de la
maladie, un MMSE (Mini Mental State
Examination), des évaluations cogni-
tives, etc.]. Des mutations au niveau de
différents gènes (CLU, CR1, PICALM et
BIN1) associés à la MA influencent les
mesures de l'imagerie neurologique (par
ex. l'épaisseur du cortex entorhinal) et la
neuropathologie, indiquant ainsi que ces
caractéristiques sont déterminées, au
moins en partie, par ces mutations géné-
tiques (27).
Quatrièmement, des modèles expéri-
sants. En effet, un nouveau lien a été éta-
bli entre les gènes impliqués dans l'en-
docytose (PICALM, BIN1 et CD2AP) et
les effets toxiques de la protéine amy-
loïde bêta dans la levure, les nématodes
et les neurones d'un rat de laboratoire
(28). Des études GWA humaines peuvent
aussi être corrélées à des dépistages
fonctionnels dans des modèles droso-
philes. Ainsi, l'effet des gènes sur les ef-
fets neurotoxiques de la protéine tau a
été étudié in vivo en examinant quelles
mutations aggravent ou rétablissent le
phénotype oculaire de modèles droso-
philes transgéniques au niveau de la
protéine tau (30).
et pour demain
type APOE reste le principal gène à
risque pour les formes complexes de la
MA (4). L'effet d'augmentation du risque
lié aux nouveaux gènes découverts est
bien moindre: entre 0,80 et 1,25
(Tableau 1). La fraction étiologique cumu-
lative du risque [population attributable
fraction = partie d'une population pou-
vant être épargnée lorsque l'exposition
être éliminée] liée aux 9 gènes à risque
non APOE s'élève à 35% (9). Cette esti-
mation va encore évoluer avec la décou-
verte d'autres gènes à risque de la MA,
de la fréquence exacte des allèles et de
l'effet des véritables mutations à risque.
Que signifient au juste ces découvertes
génétiques pour le patient? En raison des
effets à faible risque, les tests prédictifs ou
diagnostiques pour ces gènes ne sont pas
significatifs. L'ajout des mutations des
gènes CLU et PICALM au modèle de risque
du génotype APOE, à l'âge et au sexe ne
change pas grand-chose et n'est donc pas
pertinent sur le plan clinique (7). Les futurs
projets NGS qui dépisteront des mutations
fonctionnelles et plus rares ayant davan-
tage d'effets continueront à stimuler les
changements dans la pratique clinique.
ment meilleure des patients, les données
de génotype à l'échelle du génome
peuvent aboutir à une reclassification mo-
léculaire des patients en différents sous-
groupes. Étant donné que des mutations
au niveau d'un seul gène peuvent donner
lieu à plusieurs phénotypes, il convient de
dépister, au moyen de panels NGS, non
seulement les gènes spécifiques à la mala-
la MA. MMSE = mini-mental state examination, iPS = cellules souches pluripotentes induites.