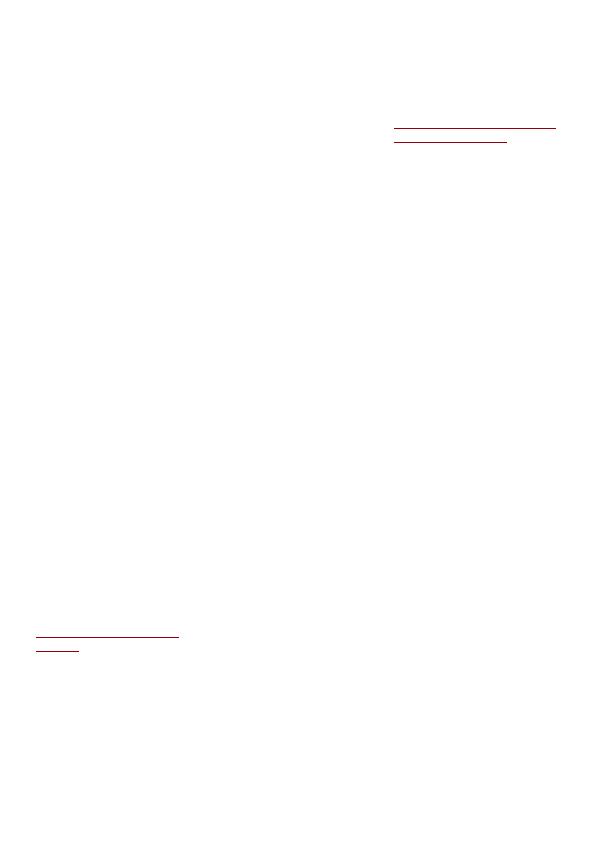
leures prestations cognitives de la part des
porteurs sains de cette mutation par rap-
port aux individus non porteurs de cette
dernière (21). La diminution du clivage de
BACE1 exerce donc un effet protecteur et
a le potentiel thérapeutique pour dimi-
nuer la quantité d'amyloïdes et contrer
ses effets toxiques.
En raison du nombre élevé de muta-
tions entrant en ligne de compte pour
la validation et le suivi (un génome
compte environ 3 millions de muta-
tions, tandis qu'un exome en compte
entre 20.000 et 50.000), l'étude WGS
constitue un véritable défi et nécessite
le plus grand soin lors du choix de
l'étude et de la sélection des patients
(notamment basée sur des caractéris-
tiques phénotypiques cliniques, bio-
chimiques ou neuropathologiques). À
cet égard, une étroite collaboration
avec les cliniciens, tant pour la col-
lecte des données cliniques et biochi-
miques que pour le suivi du patient, est
indispensable. Les initiatives conjointes
telles que le réseau Dominantly Inhe-
rited Alzheimer Network (DIAN) et le
réseau de consortium européen Early-
Onset Dementia (EOD) (22), dirigé par
les professeurs C. Van Broeckhoven
et J. van der Zee, joueront un rôle pré-
dominant dans ce cadre.
cause génétique sous-jacente
jacentes
facteurs de risque génétiques courants
dans les formes complexes de la MA.
Les mutations identifiées dans les nou-
veaux gènes comme étant associées
à la MA n'ont toutefois aucune
conséquence fonctionnelle manifeste
puisqu'elles représentent des facteurs
de risques inconnus dans le déséqui-
libre des liaisons (linkage disequili-
lèles sont involontairement associés sur
deux ou plusieurs locus). Pour la clusté-
rine par exemple, la mutation associée
à la maladie est intronique, sans consé-
quence connue sur l'expression ou la
fonction de la clustérine. Pour pouvoir
identifier les facteurs de risque sous-
jacents, il convient de continuer à
répertorier la variabilité génétique
complète des gènes GWA, à savoir les
mutations rares et fréquentes et les
variations du nombre de copies.
Pour le gène de la clustérine, l'association
a été confirmée à maintes reprises. D'ail-
leurs, une mutation fréquente corrélée à
une augmentation du niveau de transcrip-
tion de la clustérine a été identifiée dans
le lobe temporal (23). D'autres études ont
déterminé la séquence de la partie co-
dante de la clustérine. Parmi la popula-
tion belge souffrant de la MA, de rares
mutations pathogènes prédictives ont été
détectées dans les exons qui codent pour
la chaîne . On peut donc en déduire que
cette partie de la protéine joue un rôle
spécifique dans la MA (24).
Pour le gène CR1, la plupart des études
ont surtout étudié la mutation géno-
mique. Le site CR1 est complexe et ca-
ractérisé par des séquences répétitives,
ce qui rend la mutation fonctionnelle
difficile à localiser. Par le biais de notre
étude belge, nous sommes parvenus à
établir une corrélation entre la MA et
une variation fonctionnelle du nombre
de copies définissant la longueur de la
protéine CR1 et, de ce fait, à identifier le
nombre de sites de liaison pertinents
dans la cascade du complément (25). La
corrélation avec la variation du nombre
de copies explique le signal GWA initial.
Les indices de corrélation des autres
gènes (tels que PICALM, BIN1) ne se
trouvent pas dans la région du gène,
mais en amont ou en aval (Tableau 1),
compliquant ainsi la recherche de la
mutation fonctionnelle. Pour le gène
BIN1, une insertion 3bp a été décelée
environ 28kb~ en amont du gène, en-
gène et une perturbation de la biologie
de la protéine tau (26).
mutations génétiques
fiés pour la MA présentent des modes
fonctionnels. Exception faite de l'en-
semble de gènes MS4A, tous les gènes
s'intègrent en principe à la synthèse lipi-
dique (CLU, ABCA7), au système du
complément, à l'inflammation et au
système immunitaire (CLU, CR1, ABCA7,
CD33 et EPHA1), ainsi qu'aux fonctions
cellulaires synaptiques telles que l'endo-
cytose (PICALM, BIN1, CD33 et CD2AP)
(Tableau 1). Bien que les processus
exacts de la maladie ne soient toujours
pas connus, des hypothèses peuvent
néanmoins déjà être formulées. Des mu-
tations de la clustérine, une protéine
significative, peuvent influencer des fonc-
tions telles que la clairance du peptide
A42 à partir du cerveau, l'apoptose, le
métabolisme lipidique et l'inflammation.
De même, des mutations de la protéine
CR1 peuvent accroître l'activation du
complément et diminuer l'opsonisation
des plaques amyloïdes dans le cerveau.
Les mutations génétiques au niveau de la
protéine PICALM peuvent induire des
anomalies synaptiques, étant donné que
cette dernière assure le transport dans la
fusion des vésicules synaptiques (et joue
un rôle dans la formation des souvenirs).
Le caractère non arbitraire des gènes de
la MA est en outre étayé par les analyses
basées sur les voies (pathway) des études
GWA dédiées à la MA.
le mécanisme exact des mutations inhé-
rentes à la MA (Figure 2). Une première
stratégie consiste à analyser si les muta-
tions de la maladie influencent la quanti-
té de produit génique (ARN ou protéines)
ce qui peut ensuite être utilisé comme
biomarqueur précoce de la maladie ou
comme point de départ de traitements.