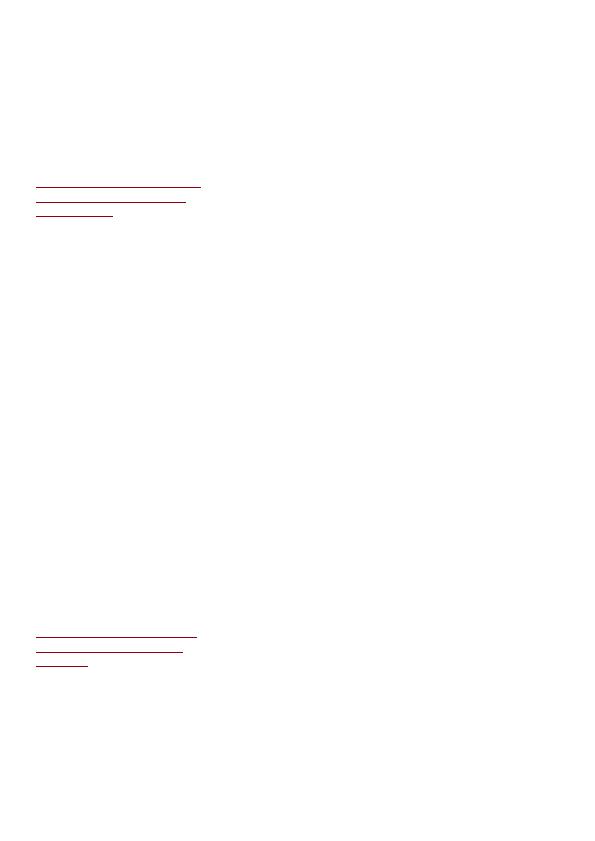
milliers, voire de millions de mutations
du génome, n'ont initialement généré
que peu de résultats reproductibles.
le plan génétique: nouveaux
gènes à risque
coordonnées à grande échelle ont per-
mis de réaliser d'importants progrès
dans la génétique de la MA complexe.
Au moins 9 nouveaux gènes à risque
ont été identifiés, le premier étant la
clustérine (CLU), identifiée dans 2
études d'association pangénomiques
(5, 6). Ensuite, une association pan-
génomique et une réplication ont été
identifiées pour les mutations géné-
tiques courantes dans les gènes CR1,
PICALM et BIN1 (5-7) et dans les gènes
MS4A, CD2AP, CD33, EPHA1 et
ABCA7 (8, 9) (Tableau 1). Cette liste de
gènes s'est ensuite allongée grâce à
l'IGAP (International Genomics of
Alzheimer's Project), qui est en train de
consolider les données de 4 grands
consortiums dédiés à la MA dans une
méta-analyse (recherches notamment
sur les facteurs génétiques ayant une
influence sur le risque de développer
la MA et à quel âge, sur l'interaction
des gènes ou des processus de la mala-
die, etc.).
précoce de la MA: nouvelle
approche
nologie de séquençage de l'ADN sont
venus relancer les recherches génétiques
concernant les patients souffrant de la
forme à début précoce et héréditaire de
la MA, notamment dans les familles trop
petites pour les études de liaison tradi-
tionnelles. Le séquençage et la compa-
raison de l'«exome» ou du «génome» de
au jour de nouvelles mutations causales.
De ce fait, ce ne sont plus les grandes
familles, mais bien le patient en tant
qu'individu qui occupe une place cen-
trale dans la génétique moléculaire de la
MA (Figure 1).
quencing) ont été publiées concernant la
maladie d'Alzheimer. La première avait
permis de découvrir des mutations au
niveau du gène NOTCH3, lequel est impli-
qué dans l'artériopathie cérébrale autoso-
mique dominante avec infarctus sous-cor-
ticaux et leucoencéphalopathie et n'avait
dès lors pas été étudié a priori dans cette
famille (12). Le fait que des mutations au
niveau d'un seul gène puissent mener à un
spectre de maladies neurodégéneratives
est une découverte importante qui avait
déjà été faite précédemment [notamment
des mutations de MAPT, un gène causal
de la démence fronto-temporale (DFT),
sont aussi présentes dans la MA; les muta-
tions PSEN1 de la maladie de Pick, les
mutations nulles GRN et les mutations
faux-sens de la MA et de la maladie de Par-
kinson; les expansions de répétition
C9Orf72, dans lesquelles un gène impor-
tant de la DFT est impliqué (13), se re-
trouvent aussi chez les patients atteints de
la MA (14)]. Ce constat a d'importantes
implications cliniques et indique qu'il est
judicieux d'analyser sur le plan diagnos-
tique tous les gènes neurodégénératifs
pour les patients dont la cause de la mala-
die est inconnue. Le séquençage classique
par la méthode de Sanger analysant les
gènes un à un peut alors être remplacé
par le séquençage de nouvelle généra-
tion (NGS Next-Generation Sequen-
cing) analysant plusieurs gènes simulta-
nément. Cette technologie stimulera le
traitement personnalisé des maladies
neurodégénératives, surtout si des théra-
pies sont développées pour cibler les
causes moléculaires au lieu des symp-
tômes cliniques. La deuxième étude
WES sur de jeunes patients atteints de
veau du gène SORL1 impliqué dans le
triage des protéines APP (15). Cette dé-
couverte est intéressante, étant donné
que des associations avec des mutations
génétiques dans ce gène avaient déjà été
démontrées dans la forme à début tardif,
notamment au sein de la population
belge (16). Dans ce gène, les mutations
responsables de la maladie ainsi que les
mutations à risque les plus fréquentes
jouent un rôle concernant la MA.
Récemment, 2 études WES consacrées à
la MA ont identifié des mutations hétéro-
zygotes au niveau du gène TREM2 (17,
18). Les mutations homozygotes de ce
gène sont connues pour être à l'origine
d'une variante comportementale de la
DFT et de la maladie de Nasu-Hakola,
également appelée PLOSL. Parmi la po-
pulation belge aussi, nous avons décou-
vert des mutations rares du gène TREM2
spécifiques aux patients souffrant de
MA (19).
monogéniques, le séquençage complet
de l'exome est généralement privilégié,
notamment en raison de son prix (l'exome
représente 1-2% du génome) et du fait
que la plupart des mutations significatives
sont situées dans la partie codante du gé-
nome. Toutefois, les mutations non co-
dantes [notamment les mutations intro-
niques du gène SOD1 dans la sclérose
latérale amyotrophique, les mutations du
promoteur APP dans la MA (20)] dé-
clenchent aussi des maladies neurodégé-
nératives, ou à tout le moins en augmen-
tent le risque. Par ailleurs, le séquençage
WGS offre une meilleure couverture de
l'exome et, compte tenu de la baisse de
prix prévue pour cette technique, elle
deviendra peut-être à l'avenir l'approche
par excellence. Grâce aux données WGS
de 1.795 habitants d'Islande, une muta-
tion APP protectrice (Ala676Thr) a été
identifiée pour la première fois sur le site
de clivage de BACE1. Cette mutation en-
traîne une diminution de la formation de