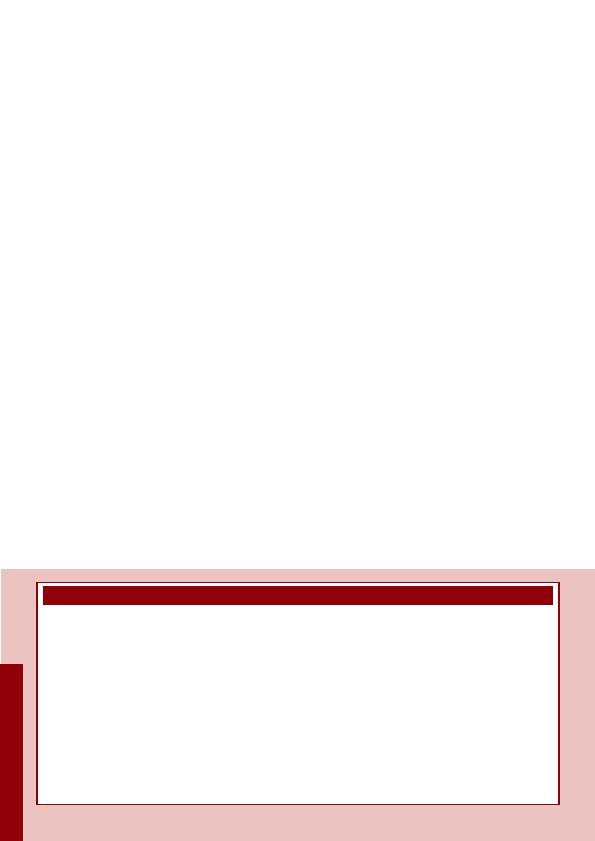
moitié des rats tout de suite après. Au
jour 3, le son est de nouveau présenté.
Le groupe de rats ayant reçu la substance
présentaient peu ou plus du tout d'anxié-
té en entendant le son (contrairement au
groupe ayant reçu une substance inof-
fensive). De toute évidence, la substance
évitait le nouvel enregistrement de la
mémoire de la peur activée (reconsoli-
dation). Ces mêmes effets ont par la suite
été obtenus avec une substance égale-
ment efficace chez l'homme. Le propra-
nolol est un bêta-bloquant (bloque les
récepteurs bêta-adrénergiques) souvent
utilisé comme produit hypotenseur.
Cette substance a effacé de manière si-
milaire la mémoire de la peur chez les
rats. Depuis lors, ce même effet a été
obtenu dans le cadre du conditionne-
ment pavlovien chez des volontaires en
bonne santé. Dans une procédure très
similaire de trois jours, on a observé une
absence complète de réaction d'anxiété
et une forte résistance à la rechute (14).
Ces résultats amènent à penser que la
mémoire de la peur peut être affaiblie a
posteriori. Il s'agit de conclusions pro-
metteuses pour le traitement des troubles
de stress post-traumatique, au cours des-
quels les patients sont tourmentés par
des souvenirs trop forts de l'événement
traumatique. Des études préliminaires
indiquent que le propranolol peut avoir
cherches supplémentaires sont néces-
saires (15). Récemment, une technique
comportementale a également été déve-
loppée, se fondant sur le processus de
reconsolidation de la mémoire (16). Du-
rant celle-ci, la mémoire de la peur est
réactivée avant de passer à l'apprentis-
sage d'élimination (son-pas de stimulus).
Dans ces conditions, les expériences de
sécurité semblent être enregistrées direc-
tement dans la mémoire de la peur et, ce
faisant, l'affaiblissent. Cette technique
est prometteuse, mais requiert des re-
cherches plus poussées.
raître des angoisses, mais elles réappa-
raissent tout aussi facilement. La thé-
rapie par exposition offre de très bons
résultats dans l'élimination de l'angoisse
à court terme. Des recherches psycholo-
giques expérimentales ont montré que
les angoisses peuvent être réduites par la
création d'une mémoire de sécurité ré-
primant la mémoire de la peur. L'incapa-
cité à activer la mémoire de sécurité
conduit à la rechute. En s'inspirant de
recherches expérimentales sur la mé-
moire, des chercheurs précliniques et
cliniques se sont penchés sur la question
du renforcement de la mémoire de sécu-
rité et de l'affaiblissement de la mémoire
ment d'interventions innovantes combi-
nant des techniques pharmacologiques
et psychothérapeutiques.
Les techniques psychothérapeutiques
induisent certains processus cérébraux
pouvant ensuite être renforcés par voie
pharmacologique. Cela crée un nouveau
paradigme de traitement réunissant enfin
des traditions de recherche riches afin de
conduire à de meilleurs traitements.
1. Hofmann SG, Smits JAJ. Cognitive-behavioral therapy for adult
controlled trials. J Clin Psychiatry 2008;69:621-32.
to Clinical Implications, ed. MG Craske, D Hermans, D
Vansteenwegen. Am Psychiatr Assoc 2006;217-33.
depression. Psychol Med 2012; Available on CJO 2012
doi:10.1017/S0033291712002267.
Neuron 1998;20:937-45.
Psychol 2012;63:129-51.
Psychiatry 2009;66:1075-82.
analysis. J Clin Psychiatry 2012;73:533-7.
2009;12:256-8.
driven traumatic imagery in post-traumatic stress disorder. J
Psychiatr Res 2007;42:503-6.
demandé si des enfants sous Rilatine seraient plus susceptibles
que les autres enfants, de développer des problèmes de toxi-
comanie, une fois adolescents.
Les psychologues ont consolidé dans leur méta-analyse les
données de 15 études de long terme dont 3 études récentes
encore en attente de publication. Leur analyse porte ainsi sur
2.500 enfants atteints de TDAH et suivis dès l'âge de 8 ans
jusqu'à l'âge de 20 ans.
Leur analyse constate que les enfants atteints de TDAH qui pren-
nent des médicaments comme la Rilatine ou d'autres de la
même classe thérapeutique n'ont pas plus de risque de consom-
de fumer plus tard dans la vie. Néanmoins, c'est le TDAH qui,
en revanche, est associé à un risque accru de toxicomanie.
Cette étude vient préciser les résultats d'une précédente étude
de 2011 de la même équipe, qui suggérait alors un risque mul-
tiplié par 2 voire 3 chez les enfants atteints de TDAH de déve-
lopper de graves problèmes de toxicomanie à l'adolescence et
à l'âge adulte, dont le tabagisme, l'excès d'alcool, l'usage de
cannabis, de cocaïne et autres substances.
Cette nouvelle étude ne contredit pas ces précédentes conclu-
sions mais constate l'absence de responsabilité de ces médica-
ments stimulants sur ce risque accru de toxicomanie.