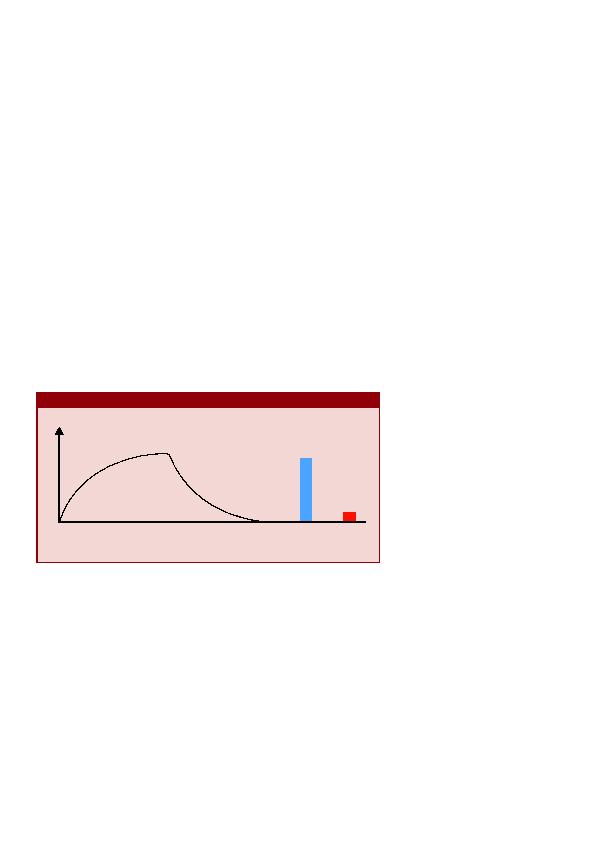
ment anxieuses) par exposition à la si-
tuation crainte jusqu'à une réduction
marquée de l'anxiété. Au cours des tests
de suivi, il est apparu que la situation
crainte déclenchait à nouveau un senti-
ment d'angoisse lorsque le patient se
trouvait dans une pièce différente de
celle du traitement (en l'absence du thé-
rapeute, etc.). Les tests dans la salle de
thérapie d'origine ne provoquaient au-
cun retour de l'angoisse. Le «contexte»
dans lequel le patient est confronté à la
situation crainte semblait déterminant
pour la rechute. Un patient peut parfaite-
ment être libéré d'une phobie des arai-
gnées pendant un traitement par exposi-
tion de 2 heures (4), mais la crainte peut
cependant revenir en cas de confronta-
tion à des araignées semblables dans un
autre contexte (par ex. à la maison).
laboratoire
peur est la procédure standard pour
l'étude des angoisses en laboratoire (5).
Un stimulus neutre (par ex. un son doux)
est proposé à plusieurs reprises et suivi à
chaque fois d'un stimulus désagréable,
voire douloureux (par ex. une stimula-
tion électrique). Il est généralement ob-
servé que le sujet commencera à présen-
ter des réactions d'anxiété en entendant
le son auparavant neutre (augmentation
de la fréquence cardiaque, sursaut, ré-
ponse électrodermale, etc.). Ces réac-
tatives, puisqu'elles peuvent mobiliser le
corps afin d'entreprendre une action (par
ex. s'enfuir). Les réactions d'anxiété de-
viennent inadaptées lorsqu'elles ne sont
plus proportionnelles au niveau réel de
menace. Les peurs phobiques, par
exemple, sont caractérisées par une an-
goisse excessive en l'absence de menace
ou en présence d'une menace faible (par
ex. arachnophobie).
réduites à l'aide d'une procédure d'ex-
position. Le retentissement répété du son
sans le stimulus permet de réduire pro-
gressivement les réactions d'anxiété par
rapport à ce son (élimination). Cela est
comparable à la réussite d'un traitement
par exposition pour les angoisses cli-
niques. Les peurs conditionnées réappa-
nation (Figure 1). Il suffit de confronter le
sujet au son dans un autre contexte (une
autre pièce, un autre éclairage, etc.)
pour que les réactions d'anxiété resur-
gissent en entendant le son. La procé-
dure la plus fiable consiste à effectuer le
conditionnement son-stimulus dans un
contexte A (une certaine pièce, un cer-
tain éclairage, etc.), l'élimination de la
peur du son dans un contexte B (une
autre pièce, un autre éclairage, etc.) et le
test final avec le son de nouveau dans le
contexte A. Les chercheurs précliniques
ont utilisé cette procédure pour exami-
neurologiques d'élimination et de re-
chute. Ces travaux illustrent les effets
d'exposition et le risque de rechute des
angoisses cliniques.
l'anxiété, élimination et
rechute
mentales ont montré que les peurs
conditionnées sont le reflet d'une «mé-
moire de la peur» (comme dans le
trouble de stress post-traumatique). Cette
mémoire reproduit l'association établie
entre le son et le stimulus (son-stimulus).
Toute nouvelle confrontation avec le son
déclenche désormais aussi le souvenir
du stimulus. Cela explique pourquoi un
son en soi anodin peut tout de même
déclencher des réactions d'anxiété in-
tenses, tout comme des phares pour une
victime d'un accident de la circulation
nocturne.
Pour l'élimination, le son est présenté de
manière répétée sans le stimulus. La di-
minution de l'anxiété doit pouvoir indi-
quer un effacement de la mémoire de la
peur (son-stimulus). Toutefois, le retour si
souvent observé de l'anxiété prouve que
la mémoire de la peur reste en elle-
même intacte. La diminution de l'anxié-
té est par contre la conséquence d'une
répression temporaire. Les expériences
d'élimination engendrent la création
d'une nouvelle mémoire, la mémoire de
sécurité (son-pas de stimulus). Cette
nouvelle mémoire réprime la mémoire
de la peur et réduit l'anxiété. À partir de
cet instant, le degré d'anxiété est déter-
miné par la mémoire la plus fortement
sollicitée: la mémoire de la peur (son-
stimulus) par rapport à la mémoire de
sécurité (son-pas de stimulus). Pour des
effets à long terme de l'élimination, une
mémoire de sécurité fortement ancrée et
facilement évoquée est indispensable.
Le retour de l'anxiété indique toutefois
que la mémoire de sécurité est souvent
plus faible que la mémoire de la peur.
é d
anxiét